3/ La construction européenne et ses enjeux
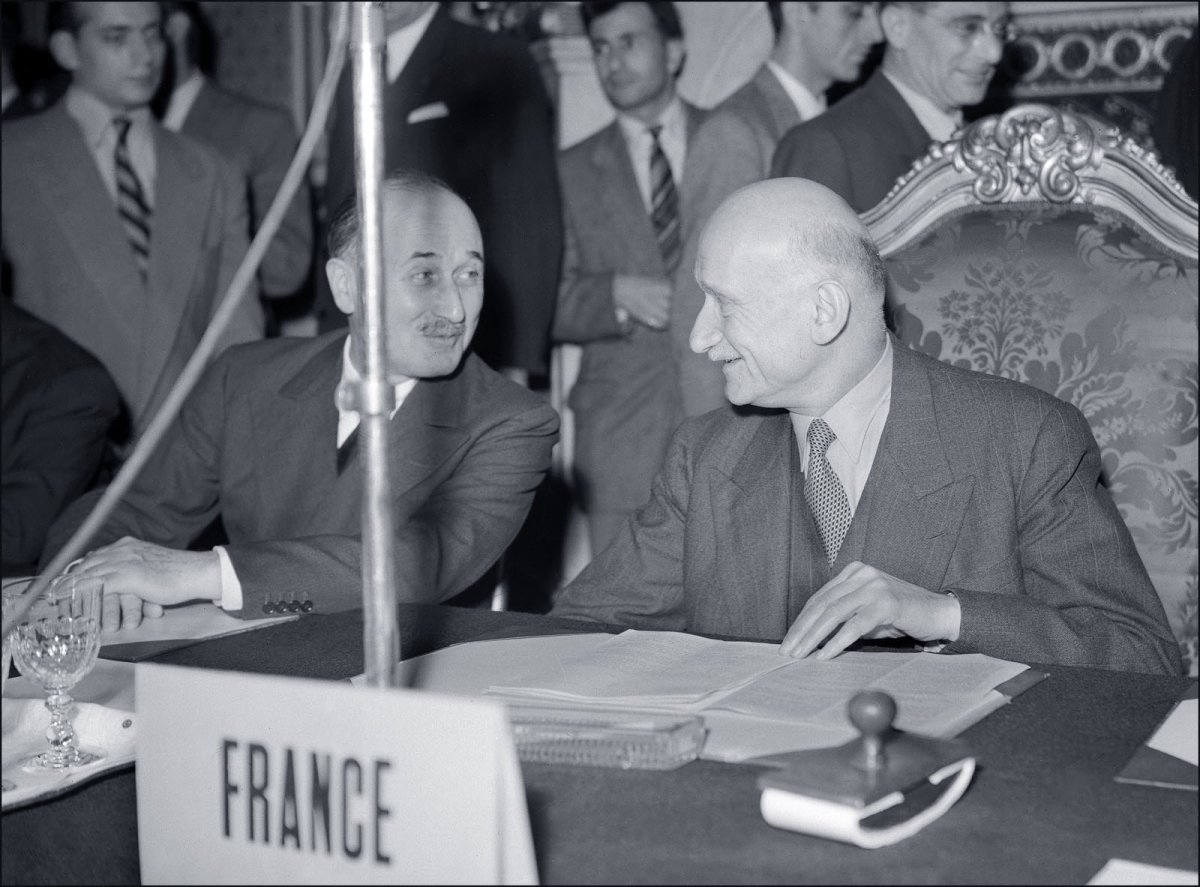
1/ L'amorce de la construction européenne : un enjeu fondamental de l'après-guerre
En 1922, Richard Coudenhove-Kalergi, un autrichien, publie une proclamation intitulée
paneuropa dans laquelle il évoque une union paneuropéenne. Plus tard, il pense à une union douanière
pouvant rendre possible des Etats-Unis d'Europe.
En septembre 1929, Aristide Briand, ministre des affaires
étrangères, lors de la 10e session de la SDN, parle d'un « lien fédéral » entre états européens...
L’idée d’unir
les Européens s’inscrit à chaque fois dans une volonté de paix pour une Europe qui a longtemps été
conflictuelle avec des rivalités de puissance importantes.
Mais ce n'est qu'après la Seconde guerre mondiale,
dans un contexte bien précis, que l'idée de construire l'Europe est véritablement élaborée et mise en œuvre.
Comme le souligne Stella Gervhas, la construction européenne est bien « une idée, un projet, une
construction. »
A/ Des facteurs favorables à une volonté d'union
Le contexte de l'après-guerre est relativement favorable à des idées neuves. La Seconde guerre mondiale
a été particulièrement destructrice pour l'Europe tant au niveau économique que démographique. Les états
doivent reconstruire, régler de multiples difficultés. Dans un premier temps, ils pensent plutôt aux châtiments
à infliger tant aux Nazis qu'aux individus ou structures ayant collaboré avec l'Allemagne.
Les vainqueurs
veulent aussi préparer, organiser l'après-guerre et la paix.
La volonté d’une Europe pacifiée est essentielle
pour comprendre la construction européenne.
Mais certains hommes pensent à juste titre qu'une telle
reconstruction et réorganisation n'est possible que dans un cadre supra-national, un cadre large qui est le
cadre européen. Les initiateurs du projet européen sont généralement favorables à long terme à une Europe
fédérale dans un contexte où domine l’Etat-Nation et la volonté de préserver sa souveraineté.
a/ La volonté d'une Europe pacifiée : la paix comme fondement de la construction européenne
-des antécédents pour des premiers pas timides
Pendant la guerre, Altiero Spinelli un militant antifasciste, est interné par par le régime de Mussolini. Il
rédige en 1943 le manifeste de Ventotene (Ventotene est son lieu d'internement) dans lequel il souhaite la fin
de la division de l'Europe en états-nations proposant une organisation fédérale de l'Europe.
En 1946,
Winston Churchill souhaite que la France et l'Allemagne se réconcilient et pense que l'Europe peut et doit
s'entendre affirmant qu'il faut édifier une « sorte d'Etats-Unis d'Europe. »
Ce même Churchill avait imaginé
en 1942 une assemblée européenne pour que les états européens agissent en concertation. En juin 1946, est
créé le mouvement pour les Etats-Unis socialistes d'Europe dont le président est André Philip dont le but est
de créer une Europe socialiste indépendante des E.-U et de l'URSS. En septembre 1947, Coudenhove-Kalergi
organise le premier congrès de l'Union parlementaire européenne (UPE) réunissant 114 députés et sénateurs
de 10 pays européens dont le but est la promotion de l'idée fédérale européenne.
Enfin en mai 1948 se tient
un congrès international sur l'Europe à La Haye avec Churchill comme président d'honneur. Lors de cette
conférence sont abordés plusieurs idées et projets comme l'existence d'une Assemblée européenne élue au
suffrage universel, la suppression de ce qui limite les échanges entre états ou encore l'élaboration d'une
charte des droits fondamentaux.
L'idée européenne fait son chemin doucement et des hommes la
promeuvent avec conviction. Certes, les premiers paraissent et sont timides puisque les réalisations ne sont
pas encore concrètes.
-des premières réalisations encourageantes
L'idée de Churchill d'une Assemblée européenne se réalise en mai 1949 avec la création du Conseil de
l'Europe (traité de Londres) dont le siège est à Strasbourg.
Au départ 10 états en sont membres : France,
Luxembourg, Belgique, Danemark, Italie, Pays-Bas, Norvège, Irlande, Suède et Royaume-Uni. Le Conseil
de l'Europe a produit en novembre 1950 la Convention européenne des droits de l'homme.
Lors d'une
conférence à Paris est également créée l'organisation européenne de coopération économique ou OECE
(16 avril 1948) dont l'objectif initial est la répartition de l'aide économique américaine.
Elle comprend 18
états membres : France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Belgique, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie ainsi que la tri-zone (américaine, française et
anglaise) allemande. L’OECE devient en 1961 l’OCDE (organisation de coordination et de développement
économique), une OCDE à laquelle appartiennent les E.-U et le Canada également.
b/ Le rôle des E.-U et l'impact de la guerre froide dans l'union de l'Europe de l'Ouest
-des E.-U favorables à la construction européenne
Les Etats-Unis jouent un rôle important dans la construction européenne qu'ils soutiennent. Ils souhaitent
la réussite de la reconstruction économique afin de favoriser la croissance économique y compris celle des
E.-U. Ils sont persuadés que cette reconstruction sera plus facile dans le cadre d'une Europe plus unie.
C'est
pourquoi ils favorisent la mise en place de l' OECE destinée à répartir l'aide Marshall proposée aux
Européens en juin 1947.
Les E.-U poussent aussi la France à partir de 1948-1949 à établir de meilleures
relations avec l'Allemagne (la partie Ouest) et notamment à intégrer la toute nouvelle RFA en 1949. L’OECE
néanmoins n’est pas dans une logique d’intégration des Etats européens. Cette construction européenne est
également pour les Américains un moyen de freiner l’expansion du communisme en Europe.
-la guerre froide comme accélérateur de cette construction
La guerre froide est un autre facteur décisif de la construction européenne. L'expansionnisme soviétique
en Europe de l'Est et la mainmise corrélative du communisme et des partis communistes dans cette partie de
l'Europe conduit à les E.-U et l'Europe de l'Ouest à réagir.
La construction européenne s'inscrit aussi dans la
logique de la guerre froide et d'une Europe qui se clive. Le plan Marshall est proposé à l'ensemble de
l'Europe mais seule l'Europe de l'Ouest l'accepte.
Le 17 mars 1948 est signé le pacte de Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg visant à la fois à penser ensemble le redressement économique mais aussi en voulant
organiser une défense commune avec la création d’un conseil militaire permanent. Les relations de plus en
plus tendues entre les deux grands a également conduit les Européens à signer en avril 1949 le pacte
Atlantique et donc d’intégrer une organisation voulue par les Américains à savoir l’OTAN. Dans un tel
contexte, les Européens de l’Ouest sont fortement liés aux Etats-Unis d’où l’idée souvent mise en évidence
d’une « Europe américaine » dans ces années 1947-1950.
B/ Les années 1950 : les premiers pas timides de la construction européenne
Le début des années 1950 sont décisives dans le processus de construction européenne : ces années
correspondent aux premiers pas de cette construction.
a/ CECA, CED : premières étapes et premières difficultés
La construction européenne se fait progressivement et en tâtonnant. La France est au départ hésitante
toujours méfiante par rapport à l'Allemagne. Les événements de 1948-1949 dont le blocus de Berlin et le
coup de Prague de février 1948 par lequel la Tchécoslovaquie devient communiste font comprendre aux
dirigeants français qu'il faut changer les relations avec l'Allemagne de l'Ouest et avoir une approche plus
pragmatique de la réalité internationale.
De plus des états comme ceux du Benelux (Belgique, Luxembourg
et Pays-Bas) sont favorables à une intégration économique. Il faut dire qu'ils se sont déjà entendu entre eux
pour former une organisation basée sur le libre échange à savoir le Benelux. Cette organisation est créée en
septembre 1944 par des gouvernements en exil à Londres.
La convention de création est signé en 1947 et
entre en application le 1er janvier 1948. Pour l'Allemagne de l'Ouest mais aussi pour l'Italie, la construction
européenne est perçue comme une réelle opportunité pour réussir la reconstruction. Quant au Royaume-Uni,
il paraît peu intéressé ne voulant pas perdre des éléments de sa souveraineté.
-la CECA, une démarche « initiatique »
Le point de départ de la construction européenne est le plan proposé par le ministre des affaires étrangères
français Robert Schuman avec sa déclaration du 9 mai 1950. Cette déclaration est fortement inspirée par
Jean Monnet commissaire au Plan. Ce dernier était favorable à la construction européenne et avait imaginé
la création d’un organisme international pour gérer et contrôler la production de charbon et d’acier entre
l’Allemagne et la France.
Les deux hommes sont donc persuadés de la nécessité de construire l'Europe et
d'établir de nouvelles relations avec l'Allemagne. R. Schuman affirmait : « l'Europe n' a pas été faite, nous
avons eu la guerre. » d'où la nécessité de voir les choses autrement.
La déclaration Schuman propose de créer
une organisation européenne devant mettre en commun les productions de charbon et d'acier de la France et
l'Allemagne. R. Schuman et J. Monnet sont conscients que la construction européenne ne peut se faire que
par étapes. Le 18 avril 1951 est signé le traité de Paris donnant naissance à la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA : le traité a pris fin en 2002). Ce traité réunit dans une démarche commune la
France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg.
L'un des objectifs du traité (il faut
rappeler que le charbon et l'acier sont deux des fondements des puissance française et allemande) est de
contribuer à la croissance économique et de favoriser les échanges. Les états signataires acceptent de
transférer une part de leur souveraineté (une petite part) en créant une institution supranationale à savoir la
haute autorité composée de 9 membres désignés pour 6 ans et chargés de veiller au fonctionnement de
l'institution ( modernisation des productions, exportations...).
Il existe également une Assemblée de la CECA
composée de 78 députés (18 pour la France, l'Allemagne et l'Italie, 10 pour les Pays-Bas et la Belgique et 4
pour le Luxembourg) : cette assemblée a un pouvoir de contrôle sur la haute autorité. Pour la première fois,
des états européens même si cela ne concerne que le charbon et l'acier ont décidé la création d'une institution
étant au dessus des états. Il faut signaler que les Britanniques n’adhèrent pas à ce projet afin de préserver leur
souveraineté.
-la CED : un échec montrant une construction délicate
Un autre projet est lancé rapidement celui de la création d'une Communauté européenne de défense
(CED) : proposition faite par Jean Monnet. Il s'agit de créer une armée européenne avec comme pour la
CECA des institutions supranationales en lien avec l'OTAN. Le traité instituant la CED est signé par les 6
états membres de la CECA le 27 mai 1952 et ratifié par la RFA, La Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas. Dans ce contexte, une commission est même créée en 1953 pour penser un projet de communauté
politique. Mais l' Assemblée nationale française rejette la CED le 30 août 1954 (319 voix contre 264) :
beaucoup de députés français sont hostiles à une telle perte de souveraineté et à la renaissance par ce biais
d'une armée allemande.
La CED ne peut donc être mise en place : il s'agit d'un échec de la construction
européenne. Cet échec révèle l'incapacité encore actuellement à construire une Europe de la défense. En
octobre 1954, la question du réarmement de la RFA dans le nouveau contexte de guerre froide est réglé par
l'intégration de la RFA dans le traité de Bruxelles qui avait été signé entre la France, le Royaume-Uni et les
états du Benelux en 1948 : un traité donnant naissance à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), une
organisation de défense collective ayant aussi des buts de coopération politique et économique.
L'entrée de la
RFA dans l' UEO permet à cette dernière d'intégrer l'OTAN en 1955. L'échec de la CED est temporaire et
l'Europe décide de se construire autrement.
Toutefois en 1954 la construction européenne semble être dans
sa première impasse : il faut donc relancer le projet. L’échec de la CED marque la tension essentielle dans
cette construction européenne entre fédéralisme et souverainisme sachant que les Etats veulent préserver
leurs souverainetés et ne semblent pas prêts à construire véritablement une Europe fédérale. L’échec d’une
politique de défense commune est durable même si depuis le traité de Maastricht de 1992 a été mis en place
une politique étrangère et de défense commune. Cet échec induit aussi une dépendance sur le plan militaire
par rapport aux Etats-Unis et à l’OTAN.
b/ Des traités majeurs : les traités de Rome
-les traités de Rome : une étape décisive
Après l’échec de la CED, il faut relancer le projet européen ce qui se réalise en 1955 lors d’une conférence
organisée en Italie à Messine. Lors de cette conférence, il est proposé de continuer le processus européen en
développant « des institutions communes » mais aussi par « la fusion progressive » des économies. »
Pendant deux ans, on réfléchit et pense à la mise en œuvre de cette relance ce qui aboutit aux traités de Rome
en mars 1957. On peut donc voir que la construction européenne repose sur des temps d’arrêt et qu’il est
souvent nécessaire de relancer la construction européenne.
Une étape essentielle de la construction européenne est bien la signature des traités de Rome en mars 1957
par la France, la RFA, l'Italie et le Benelux. Le premier traité permet la création de la Communauté
économique européenne (CEE) et le second la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA ou
Euratom). Ces traités sont entrés en application en janvier 1958 l'objectif de la CEE est la mise en place d'un
marché commun ainsi qu'un rapprochement des politiques économiques des états membres.
Euratom a
comme but la formation et le développement d'une industrie nucléaire européenne. Par rapport à la CECA, la
CEE est beaucoup moins supranationale. En effet, l'institution clé est le Conseil des ministres européens
composés des ministres des 6 états membres. La commission européenne qui est créée a simplement un droit
d'initiative et l'Assemblée européenne (142 délégués désignés par les parlements des états membres) ancêtre
du Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif. Le démantèlement des droits de douane et des restrictions
dites quantitatives (quotas) entre 1958 et 1970 permet de multiplier par 6 les échanges entre les états
membres. Avec les traités de Rome, la construction européenne est passée à une vitesse supérieure au moins
sur le plan économique.
Le Royaume-Uni tente alors de lancer un projet concurrent en créant en 1959 par le traité de Stockholm
l’AELE (Association économique de libre-échange) à laquelle adhèrent le Danemark, la Suède, la Norvège,
le Portugal, la Suisse et l’Autriche.
Mais l’AELE n’est pas dans la même logique intégrative que la CEE.
L’AELE est une simple zone de libre-échange alors que la CEE aboutit à une union douanière avec mise en
place d’un tarif douanier extérieur commun. Au sein de l’AELE, il n’y a pas non plus de volonté
d’harmoniser les politiques économiques à l’inverse de la CEE et au niveau institutionnel, l’AELE ne repose
pas sur des institutions( elle s’appuie seulement sur un secrétariat permanent à Genève et un Conseil des
ministres).
-une Europe d’abord à six
C'est donc une Europe à 6 qui se met en place au début des années 1960 .Dans les années 1959-1962, les
échanges intracommunautaires se libéralisent au niveau des produits industriels. Les 6 décident de
développer une politique agricole commune : la PAC. Celle-ci est une des plus anciennes politiques
communes de la communauté européenne puisqu'elle date de 1962.
Ses objectifs sont l'accroissement de la
productivité, d'avoir des marchés agricoles stables, d'assurer un niveau de vie correct aux agriculteurs... Elle
repose sur des systèmes d'aides et de protection.
Il s’agit d’organiser les marchés agricoles européens, de
fixer des prix communs.
Dans le cadre de la PAC est ainsi crée le Fonds européen d’organisation et de
garantie agricole (FEOGA) qui a en charge la PAC et son financement. (voir plus bas)
Le 1er juillet 1968, l'union douanière est une réalité : les droits de douane ont été supprimés.
Toutefois, à
deux reprises, en 1963 et 1967 la France s'oppose à l'adhésion du Royaume-Uni dans la CEE. Entre juin
1965 et janvier 1966, le général de Gaulle s'était opposé à la prise de décision à la majorité lors des conseils
des ministres préférant le système de l'unanimité. Même si la construction européenne a pris forme, on est
encore très loin d'une Europe unie notamment sur le plan politique. Lors de la conférence de La Haye en
décembre 1969 une union économique et monétaire est envisagée mais ce projet n’aboutit pas.

2/ Les premiers approfondissements et élargissements : la construction d'une Europe économique et institutionnelle
A/ Une Europe qui fonctionne
a/ Un accélérateur économique
-des économies dynamisées
La construction européenne est incontestablement un accélérateur économique favorisant la croissance. Les
échanges entre les états membres augmentent : puisque la part des échanges intracommunautaires est passé
en ce qui concerne la France de 26% en 1958 à 55% en 1973 et pour les exportations de 28 à 56% les
économies des 6 sont de plus en plus liées et interdépendantes.
Le PNB moyen des états progressent de 70%
entre 1957 et 1970. La construction européenne participe à la croissance économique des 30 glorieuses en
favorisant la demande.
-des marchés qui s'ouvrent
Les marchés se sont ouverts et pas seulement entre les 6 états membres. La CEE a ainsi signé les accords
de Yaoundé avec des états africains nouvellement indépendants. La CEE s'ouvre aussi à des partenaires non
européens s'inscrivant dans une perspective plus large. Au début des années 1970, des accords de libre
échange sont signés avec les membres de l'Association européenne de Libre échange (AELE) : en juillet
1972 avec l'Autriche, l'Islande, la Suisse et la Suède puis en 1973 avec la Norvège et la Finlande.
Il faut
rappeler que l' AELE avait été initiée en 1960 par le Royaume-Uni afin de créer une zone de libre échange.
En 1960, en plus du Royaume-Uni, adhèrent à l' AELE : la Norvège, le Danemark, la Suisse, le Portugal,
l'Autriche et la Suède. L' Islande adhère en 1970 (La Finlande en 1986, le Liechtenstein en 1991).
b/ La mise en place de politiques communes
-la PAC : une réussite trop belle ?
La PAC avait donc plusieurs objectifs : un meilleur niveau de vie pour les agriculteurs, des marchés stables,
la sécurisation des approvisionnements et de ce fait une indépendance agricole et des prix raisonnables pour
les consommateurs. La PAC suppose la libéralisation des échanges, l'harmonisation des règlements entre les
états membres, la fixation de prix agricoles communs... les marchés agricoles sont également protégés contre
les importations à bas prix par des taxes sur les produits importés et des changements des cours mondiaux.
Enfin les exportations agricoles sont favorisées afin que les agriculteurs européens soient compétitifs à
l'échelle mondiale : elles bénéficient d'un soutien par le versement de la différence de prix aux agriculteurs
entre les cours européens et les cours mondiaux.
Le financement de cette PAC se fait par le FEOGA (Fonds
européen d'organisation et de garantie agricole. La CEE rachète même ce qui est produit en trop afin de les
stocker et de le mettre ultérieurement sur les marchés.
-mais des limites réelles
La PAC a pour conséquences d'améliorer la productivité et les productions sont constamment en hausse.
Ainsi le taux d'auto-approvisionnement de la CEE est passé entre 1973 et 1984 de 90% à 123% pour le
Sucre, de 90% à 105% pour les céréales... Mais le problème est que dans plusieurs domaines (comme la
production laitière) la production est supérieure à la consommation donc il y a surproduction.
Le stockage de
cette surproduction tout comme la restitution aux agriculteurs de la différence entre les cours européens et les
cours mondial a un coût de plus en plus élevé. Parallèlement, de nombreux états non membres de la CEE
contestent un système qui protège l'agriculture de la CEE. La politique agricole commune est l'exemple d'une
politique qui a « trop bien marché ». Elle a néanmoins permis de faire de l'agriculture européenne la 2e
agriculture mondiale derrière les E-U.
B/ Une Europe en voie d'élargissement progressif
La réussite économique de la CEE pousse certains Etats à vouloir intégrer la CEE. Très tôt la CEE
conclut des accords d’associations avec plusieurs Etats : la Grèce en 1961, la Turquie en 1963, Malte en
1970. En 1963, la CEE a aussi passé des accords avec plusieurs pays africains avec les accords de
Yaoundé...
La CEE n’est pas repliée sur elle-même. Elle est devenue attractive et c’est pourquoi dès 1961 le
Royaume-Uni demande à intégrer la CEE tout comme le Danemark, l’Irlande ou encore la Norvège.
a/ Le Royaume-Uni : « je t'aime, moi non plus »
Le Royaume-Uni avait été réticent à s'inscrire dans le projet européen dans les années 1950 . une partie des
hommes politiques britanniques voyaient dans l'éventuelle adhésion au projet européen la perte de la
souveraineté britannique. Le Royaume-Uni accordait également beaucoup d'importance à sa relation
privilégiée avec les E.-U ainsi qu'au Commonwealth. Son intérêt pour le projet européen ne pouvait être que
limité.
Comme nous l'avons vu le Royaume-Uni a constitué en 1959 une Association économique de libre
échange (AELE) par le traité de Stockholm devant être en position de concurrence par rapport à la CEE.
Mais l' AELE est une simple zone de libre échange sans harmonisation des politiques économiques et sans
véritables institutions à l'exception d'un secrétariat dont le siège est à Genève.
-le cas britannique confrontée à ...
C'est un gouvernement conservateur celui de Macmillan qui propose en 1961 la candidature du Royaume-
Uni à l'entrée dans la CEE. Les Britanniques avaient changé d'avis en grande partie pour des raisons
économiques. La croissance économique est plus importante pour les 6 états membres de la CEE que pour le
Royaume-Uni.
Mais la France par le biais du général de Gaulle oppose son veto à l 'entrée du Royaume-Uni
en 1963 ; une opposition réitérée en 1967 suite à une seconde demande cette fois d'un gouvernement
travailliste : celui de Harold Wilson.
-l'hostilité française
Le général de Gaulle est hostile à l'intégration du Royaume-Uni surtout pour des raisons politiques. L'entrée
du Royaume-Uni dans la CEE selon lui permettrait aux E.-U d'influer sur la politique européenne : le
Royaume-Uni est perçu comme le cheval de Troie des E-U.
Le général de Gaulle n'a donc aucune confiance
dans la politique menée par les Britanniques.
Les choses vont évoluer avec l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou. Lords d'une conférence
organisée à La Haye en décembre 1969, Pompidou retire le veto de la France à l'adhésion du Royaume-Uni.
Un accord est signé entre les six membres de la CEE et le Royaume-Uni le 23 juin 1971.
b/ 1973 : un premier élargissement
-trois nouveaux entrants...
Des négociations se sont également ouvertes avec l'Irlande et le Danemark. Le 22 janvier 1972 est signé le
traité d'adhésion : entre mai et octobre, l'adhésion est ratifiée soit par le Parlement comme au Royaume-uni
soit par référendum comme en Irlande (83% de oui) et au Danemark ( 63,5%). Le 1er janvier 1973, trois
nouveaux états intègrent donc la CEE : le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande.
L' Irlande voit dans
cette adhésion des opportunités pour davantage se développer en étant moins dépendant du Royaume-Uni.
Quant au Danemark, il est le premier état scandinave à rejoindre la CEE après le refus d'adhésion par
référendum de la Norvège en septembre 1972 ( 53% de voix contre). La CEE est passée de 6 à 9.
-dans un contexte délicat
Le contexte de ce premier élargissement n'est pourtant guère favorable. La CEE est confrontée à la crise
monétaire en provenance des E.-U : les E.-U abandonnent les taux de change fixes contrairement à ce qui
avait été fixé lors des accords de Bretton Woods. Les monnaies des états membres de la CEE deviennent
fluctuantes. Parallèlement le premier choc pétrolier de 1973-1974 affecte la croissance économique : la fin
des « 30 glorieuses » s'opère. Les états de la CEE entrent dans une période de crise économique. Dans ce
contexte délicat, les Britanniques demandent de renégocier un certain nombre de choses en particulier leur
contribution au budget de la CEE. En 1979 , Margaret Thatcher fait la même demande obtenant une
réduction notable de la participation financière britannique à partir de 1984 : le R-U par ses demandes
contribue à une construction européenne bancale et à la carte.
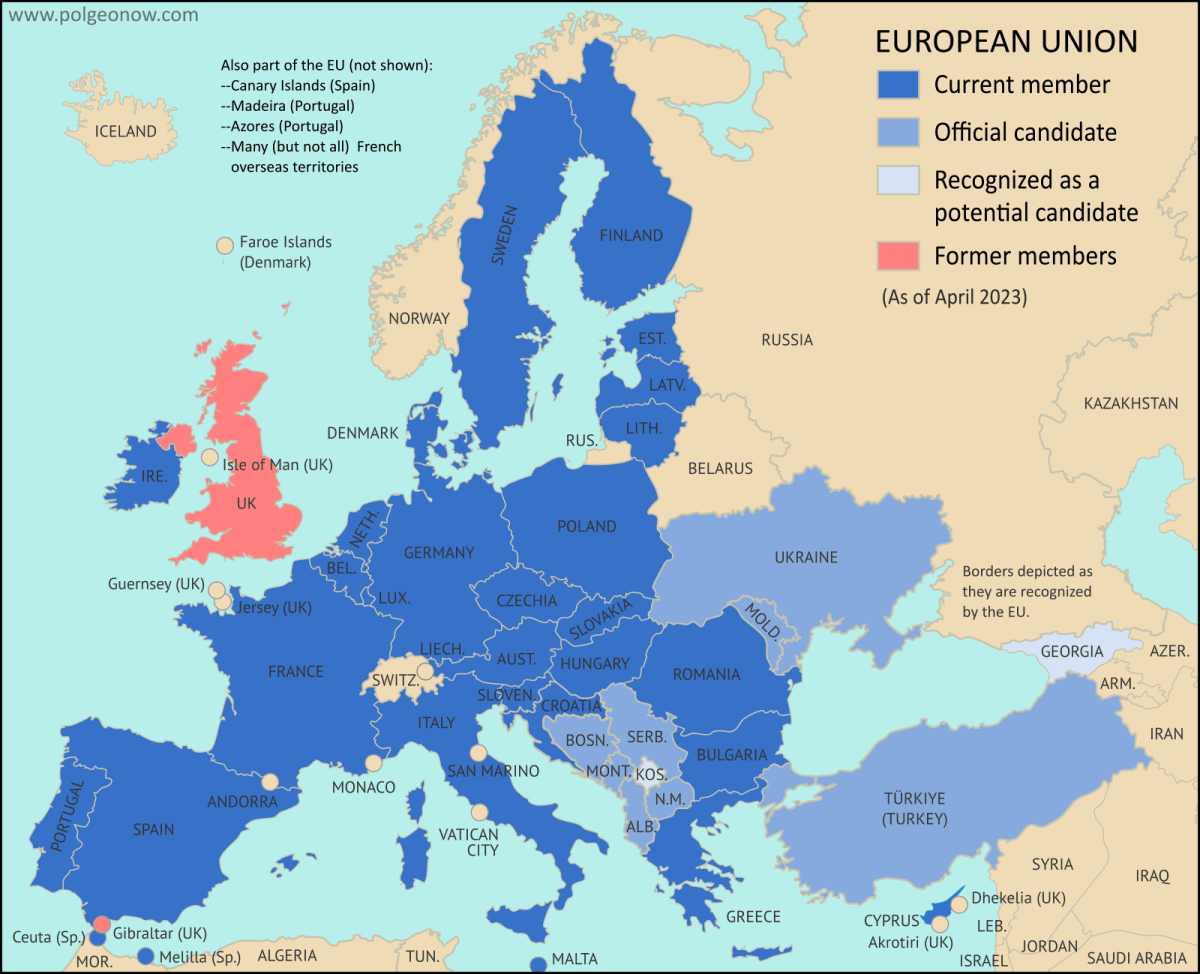
3/ Une Europe de plus en plus plus intégrée et élargie pour des enjeux essentiels
Au début des
années 1970 avant que la crise ne se déclenche, les dirigeants européens la création d’une Union économique
et monétaire qui ne voit pas le jour dans un tel contexte. Face à cette crise, les Etats membres ne mènent pas
une politique économique commune montrant à cet égard ses limites.
Une nouvelle relance de la
construction européenne s’opère toutefois dans les années 1980. De nouvelles initiatives sont lancées comme
le projet scientifique Eurêka en 1985 ou le programme Erasmus en 1987 mais il est nécessaire d’aller encore
plus loin.
A/ Une Europe s'approfondissant par étapes
a/ L'acte unique européen : un temps fort de la construction européenne
L'Acte unique européen décidé en 1985 sur une proposition de la commission européenne et adopté par le
Conseil européen réuni à Bruxelles en mars 1985, est un moment important d'une intégration
supplémentaire des économies européennes.
L 'Acte unique est signé le 17 février 1986 à Luxembourg,
entre en vigueur en juillet 1987 avec la date butoir du 31 décembre 1992 pour la réalisation du marché
unique Auparavant, à la fin des années 1970, les membres de la CEE avaient mis au point un système
monétaire européen (SME) afin d'atténuer les fluctuations des différentes monnaies.
-la formation progressive d'un véritable marché unique
L'Acte unique européen est fondamental car il décide, pour 1993, la formation d'un véritable marché
unique dans lequel les marchandises, les capitaux et les hommes circuleront librement. L'acte unique est de
ce fait décisif dans ce que la CEE devient économiquement : une réelle zone de libre échange.
Pour favoriser
ce marché unique, il est décidé d'accroître les compétences de la communauté européenne. Cet acte unique
est donc entré en application en 1993.
-des perspectives nouvelles
Des perspectives nouvelles s'offrent à l'Europe en particulier au niveau économique : des perspectives à
développer et approfondir. L'intégration économique est de ce fait importante renforçant le poids de la CEE.
La CEE décide donc de pousser son intégration et devient un modèle pour les Unions régionales.
En effet,
elle est l’union régionale qui pousse le plus loin l’intégration de ses membres.
Il faut ajouter d’autres accords importants dont les accords de Schengen signés en 1985. Ces accords ont
créé un espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires tout en veillant à une sécurité des
frontières extérieures de l’UE. L’espace Schengen comprend actuellement 22 états membres de l’UE (le
Royaume-Uni, l’Irlande, la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie n’en sont pas membres) et 4 états associés qui
n’appartiennent pas à l’UE/ Norvège, Suisse, Islande et Liechtenstein.
b/ De Maastricht à l'Euro : une Europe renforcée
-le traité de Maastricht : un autre temps fort
L'Acte unique européen est complété par un autre moment fort à savoir le traité de Maastricht signé en
1992. Ce traité comporte des aspects économiques certes mais aussi des aspects politiques.
Economiquement, ce traité prévoit la mise en œuvre d'une monnaie commune aux états membres afin
d'approfondir encore davantage l'Europe économique notamment par une intégration monétaire. Le traité de
Maastricht permet la création d'une citoyenneté européenne avec la possibilité pour tout membre d'un état
de la CEE de participer si il réside dans une commune d'un état membre de voter aux élections municipales.
Il s'agit d'une première étape vers une intégration citoyenne. Il décide aussi de mettre en place
progressivement une politique étrangère et de défense commune.
Enfin il opère un changement de nom : la
CEE devient l'Union européenne. La ratification du traité se fait dans les différents états membres : le traité
est approuvé difficilement par référendum en France en septembre 1992 (51% de oui) et est même rejeté au
Danemark (le 2 juin par 50,7% des danois) avant d'être accepté lors d'un second vote en 1993 (en mai 1993).
-l'Euro et la zone euro : une intégration économique et monétaire renforcée
L'un des axes forts de Maastricht est la décision d'une union monétaire. La première étape est la réalisation
entre juillet 1990 et décembre 1993 de la libre circulation des capitaux. Une seconde étape à partir de 1994
met en place une meilleure coordination des politiques économiques et définis des critères à respecter afin
d'adopter la monnaie unique (déficit public inférieur à 3% du PIB, une dette publique inférieure à 60% du
PIB, une inflation qui ne doit pas dépasser de plus de 1,5% celle des 3 pays où les prix sont les plus
stables...).
La dernière étape est la création d'une monnaie unique au 1er janvier 1999 ainsi que d'une Banque
centrale européenne (BCE dont le siège est à Francfort). L' Euro devient une monnaie unique pour les
états ayant choisi d'adhérer à ce principe.
En 1999, onze états en font partie : Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne,Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal. La Grèce rejoint la zone euro en
2001, la Slovénie en 2007, Chypre en 2008 tout comme Malte, la Slovaquie en 2009, l'Estonie en 2011, la
Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015.
B/ Une Europe toujours plus large
L'UE va parallèlement poursuivre son élargissement passant de 9 en 1973 à 28 en 2013. Ce processus
d’élargissement est fondamental et va s’accélérer avec la fin de la guerre froide et les perspectives
d’élargissement vers l’Europe de l’Est.
a/ de 9 à 15
-un élargissement vers le sud
La CEE s'élargit d'abord vers l'Europe du Sud : la Grèce en 1981 et l'Espagne et le Portugal en 1986. La
CEE et la Grèce avait noué une association en 1962 mais les relations s'étaient nettement refroidies avec la
période de dictature de la Grèce entre 1967 et 1974 (« régime des colonels »). Les relations ont repris avec le
retour de la démocratie. La Grèce pose sa candidature en juillet 1975, le traité d'adhésion est signé en mai
1979 pour prendre effet en juillet 1981.
L' Espagne avec la dictature de Franco ne pouvait prétendre à entrer dans la CEE : la mort de ce dernier en
novembre 1975 et la mise en place de la démocratie vont permettre de changer la donne. Les négociations
entre l'Espagne et la CEE aboutissent à l'adhésion au 1er janvier 1986. Quant au Portugal, son entrée était
impossible du temps de la dictature de Salazar (ce dernier décède en 1970). La révolution dite des oeillets en
1974 permet au Portugal la transition vers la démocratie. Le Portugal intègre la CEE au 1er janvier 1986.
-1995 : l'entrée de pays riches
L' Acte unique européen tout comme le traité de Maastricht poussent la CEE à définir de nouvelles relations
avec les états membres de l' AELE : Norvège, Finlande, Autriche, Suède, Suisse et Liechtenstein avec
lesquels elle a des relations économiques par le biais d'accords bilatéraux.
Parallèlement certains états de l'
AELE voit la formation d'un marché unique comme un élément intéressant. Des négociations aboutissent le
2 mai 1992 à Porto à la signature d'un traité créant l'espace économique européen, (EEE) entre les membres
de la CEE et de l' AELE. L'EEE devient une étape pour l'intégration de nouveaux états dans l'Union
européenne. L' Autriche, la Finlande et la Suède décident d'intégrer l'UE ce qui se réalise au 1er janvier
1995. par contre, la Norvège et la Suisse rejettent l'adhésion par référendum et l'Islande préfère rester dans le
cadre de l' EEE. L' Union européenne se compose désormais de 15 états membres.
b/ Un élargissement fondamental vers « l'autre Europe »
Un élargissement plus fondamental et important se prépare avec la fin du communisme en Europe de l'Est en
1989. la réunification de la RFA et de la RDA tout comme l'abandon du communisme, l'éclatement de
l'URSS modifient l'Europe. Les dirigeants de l’UE vont proposer aux pays d’Europe de l’Est d’intégrer le
projet européen à terme à condition de remplir un certain nombre de critères.
-2004 : 10 nouveaux entrants modifiant la nature de l'Europe : un « big bang » (Pascal Fontaine)
Le conseil européen qui se tient à Copenhague en juin 1993 affirme la vocation des pays d'Europe centrale et
orientale (PECO) à entrer dans l'UE. Cette entrée est possible à condition de remplir trois critères : un critère
politique qui est la présence d'institutions stables avec une garantie de la démocratie et des droits de
l'homme ; un critère économique à savoir l'existence d'une économie de marché viable c'est-à-dire capable
d'affronter la concurrence en Europe et enfin le critère de la reprise des acquis communautaires soit la
capacité à assumer les obligations liées à l'appartenance à l'UE.
Dès lors entre 1994-96, 10 états font acte de
candidature : la Hongrie (1994), la Pologne (1994), la Bulgarie (1995), l'Estonie (1995), la Lettonie (1995),
la Lituanie (1995), la Slovaquie (1995), la Roumanie (1995), la République tchèque (1996) et la Slovénie
(1996). Deux états hors Europe centrale avait posé leur candidature en 1990 : Chypre et Malte.
Les
négociations d'adhésion commencent en 1997. Le 1er mai 2004, dix nouveaux états adhèrent à l'UE :
Chypre, Malte, Hongrie, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Lituanie, Lettonie et
Estonie. Il s'agit pour reprendre l'expression de Pascal Fontaine d'un véritable « Big bang ». La population
de l'UE passe de 275 millions d'habitants à 450 millions.
-2007 à 2013 : l' élargissement se poursuit plus timidement
L'élargissement se poursuit avec la signature des traités d'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie en avril
2005 avec une entrée effective en janvier 2007. en 2007, l'UE dépasse les 500 millions d'individus. En
octobre 2005, des négociations s'ouvrent avec la Croatie et avec la Turquie qui n’aboutissent pas pour la
Turquie. La Croatie signe un traité d'adhésion en 2011 puis devient membre de l'UE au 1er juillet 2013 :
l'UE compte désormais 28 états membres.
C/ Des enjeux déterminants et des tensions
La construction européenne n'est pas achevée : l'Union européenne peut à la fois s'approfondir et poursuivre
ses élargissements. L'UE est d'ailleurs à la croisée des chemins : veut-on plus d'Europe ou une Europe moins
présente ? Le Brexit de 2016 marque incontestablement un ralentissement de la construction européenne et
de nombreuses questions se posent quant à la pérennité du projet européen.
a/ Des enjeux politiques et économiques
L'UE est confrontée à plusieurs enjeux et défis qu'elle doit tenter de relever si elle veut poursuivre sa route.
Elle est actuellement en difficulté avec des divergences importantes entre ses états membres sur ce qu’elle
doit être.
-les enjeux politiques : jusqu'où poursuivre l'élargissement ?
Veut-on une Europe fédérale ou non ?
Les enjeux politiques sont importants surtout dans un contexte de crise. En effet, l'UE est confrontée depuis
2008 à une crise économique qu'elle ne parvient pas à surmonter. Elle doit affronter des problèmes externes :
migrations, interventions éventuelles à l'extérieur... sans oublier une lutte contre un euroscepticisme
grandissant.S’est ajouté cette année la crise sanitaire liée au Covid 19 avec des Etats européens dans
l’incapacité d’apporter des réponses communes tant sur le plan sanitaire qu’économique.
L'un des enjeux est précisément la nature de l'Union européenne. Cette union doit-elle se confondre avec
l'Europe avec de nouvelles entrées ? De nouveaux élargissements sont envisagés en particulier pour les états
des Balkans dont la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine...
Le cas de la Turquie se pose de façon
récurrente : la Turquie peut-elle adhérer à l'UE ? Est-elle ou peut-elle être européenne ?
Dans une autre perspective, veut-on à terme une Europe fédérale ou le maintien d'une Europe des nations ?
Ou plus simplement veut-on une intégration politique et institutionnelle supplémentaire avec des états prêts à
abandonner des éléments de leur souveraineté ? Ces questionnements sont fondamentaux pour donner une
direction au projet européen.
-les enjeux économiques : veut-on une Europe plus sociale ?
L' Union est-elle un simple marché ?
Autres enjeux : les enjeux économiques et sociaux. L' Union européenne doit -elle être une simple zone de
libre échange ou une économie plus intégrée où les politiques fiscales, sociales seraient harmonisées ? L'
Union européenne doit-elle davantage protéger son marché ou s'ouvrir davantage ? Dans le cadre d'une
ouverture plus importante, doit-elle signer un accord de libre échange avec les Etats-Unis à savoir le traité
transatlantique ? L’UE comme le font les Etats-Unis ou encore la Chine ne doit-elle pas pratiquer une
véritable politique protectionniste et de réindustrialisation ?
b/ Des tensions et des perspectives peu enthousiasmantes
L'UE est incontestablement entrée dans une période de turbulences politiques et économiques induisant une
perte de confiance dans sa capacité à réagir. Les citoyens européens n’ont plus confiance dans les institutions
européennes, une perte de confiance se traduisant par une fort euroscepticisme.
-des tensions internes qui se multiplient : zone euro en crise, cas britannique...
Les tensions internes à l'UE ces derniers mois se sont accrues. La zone euro connaît une crise économique
certaine dont l'un des épisodes est la crise de la dette affectant plusieurs états : Grèce, Espagne, Italie,
France...
Le cas de la Grèce est particulièrement marquant car à cette occasion a été évoquée une sortie
forcée de l'Euro mettant de fait en péril l'unité de cette zone euro. C'est une crise qui a de plus mis en exergue
les différences de point de vue entre états européens (France et Allemagne notamment).
Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de son premier ministre David Cameron, envisageait une éventuelle
sortie de l'Union européenne (le Brexit) : un référendum est organisé en 2016. En juin 2016, le référendum a
lieu aboutissant au Brexit. La sortie du Royaume-Uni est un tournant car c’est la première fois que l’UE se
rétrécit alors qu’elle était dans une dynamique d’élargissement (s).
Au Brexit se greffent des divergences à plusieurs niveaux notamment sur les politiques à mener par rapport
aux migrants avec une crise des migrants ayant fortement affecté l’UE en 2015 sans oublier les tensions entre
les pays d’Europe de l’Ouest et ceux d’Europe de l’Est (Hongrie, Pologne).
L’UE connaît des fractures qui
freinent la poursuite du projet européen.
De façon plus générale, de plus en plus d'européens doutent de l'Union européenne et de son fonctionnement
(l'euroscepticisme) : des doutes se traduisant par de fortes abstentions aux élections européennes et par une
montée des mouvements anti-européens qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite.
-des difficultés par rapport à l'environnement proche : Ukraine, Russie : que faire ?
L'UE est enfin confrontée à des difficultés par rapport à son environnement proche. La crise ukrainienne
depuis 2014 traduit une difficulté à définir des positions claires par rapport à la Russie. Cette crise est
révélatrice de l'incapacité de l'UE à réellement peser politiquement. La crise actuelle des migrants est aussi
révélatrice des tensions entre membres de l'UE : certains états n'étant aucunement favorable à l'ouverture des
frontières et à l'accueil des migrants (Pologne, Hongrie...).
Bilan
La construction européenne repose sur un projet politique et économique qui n’est pas encore achevé et qui
semble même à l’arrêt. Ce projet est en panne et a besoin d’être relancé dans un contexte géopolitique
mondial tendu : les difficultés pour l’UE sont nombreuses. L’Union européenne semble être à un tournant de
son histoire.
