La République
Introduction
A. Présentation de Platon
Platon est l'un des penseurs les plus éminents de l'Antiquité classique. Né à Athènes vers 427 ou 428 av. J.-C. dans une famille aristocratique, Platon est surtout connu pour sa contribution à la philosophie, à la politique et à l'éducation.
Il était un élève de Socrate, un philosophe dont la méthode dialectique, basée sur le questionnement critique, a eu une profonde influence sur la pensée de Platon. Cependant, après l'exécution de Socrate en 399 av. J.-C., Platon s'est éloigné des enseignements socratiques pour développer ses propres idées philosophiques.
Platon a fondé l'Académie à Athènes vers 387 av. J.-C., l'une des premières institutions éducatives supérieures en Occident. Cette académie a joué un rôle clé dans la diffusion de la philosophie platonicienne et a fonctionné pendant des siècles.
Ses œuvres les plus célèbres sont ses dialogues philosophiques, qui prennent la forme de conversations entre Socrate et d'autres personnages. Parmi les dialogues les plus connus figurent "La République", "Le Banquet", "Phédon" et "Parménide". Dans ces dialogues, Platon explore une variété de sujets, notamment la justice, la vertu, la connaissance, l'éthique, la politique et l'éducation.
Platon a élaboré la théorie des Formes (ou Idées), selon laquelle le monde sensible n'est qu'une copie imparfaite du monde des Formes parfaites et éternelles. Cette théorie a eu une influence profonde sur la métaphysique occidentale.En politique, Platon a imaginé la cité idéale (Kallipolis) dans "La République", dans laquelle les dirigeants, les gardiens-philosophes, sont formés pour le bien commun. Il a également abordé la question de la justice et de la vertu dans ses dialogues.
Platon a été un défenseur fervent de l'éducation comme moyen de former des individus vertueux et d'améliorer la société. Ses idées sur l'éducation ont influencé les systèmes éducatifs occidentaux pendant des siècles.L'héritage philosophique de Platon est immense. Ses écrits ont influencé la pensée occidentale à travers les âges, de la philosophie médiévale à la philosophie moderne. Son concept des Formes, son exploration de la politique idéale et ses idées sur l'éducation continuent d'être étudiés et discutés dans le monde entier, attestant de la persistance de son influence dans la philosophie contemporaine. Platon demeure un géant intellectuel dont les idées continuent d'inspirer la réflexion et la recherche dans de nombreux domaines.
B. Présentation de l'œuvre "La République" de Platon
"La République" est l'une des œuvres majeures de Platon, philosophe grec de l'Antiquité, et elle est souvent considérée comme l'un des piliers fondateurs de la philosophie politique et de la pensée utopique. L'ouvrage est un dialogue socratique qui met en scène Socrate, le célèbre maître de Platon, ainsi que plusieurs autres personnages, dont Glaucon et Adimante, ses frères, et Thrasymaque, un sophiste.
Rédigée vers 380 av. J.-C., "La République" se compose de dix livres, chacun abordant des sujets philosophiques et politiques essentiels. Dans cet ouvrage, Platon utilise le dialogue comme une méthode d'investigation intellectuelle, un moyen de poursuivre la vérité à travers des débats et des questionnements.
L'idée centrale de "La République" est la quête de la justice et la construction de la cité idéale, Kallipolis, censée incarner la justice dans son état le plus pur. L'œuvre vise également à explorer la nature de la vertu, du savoir et du pouvoir politique, tout en critiquant les régimes politiques existants de son époque.
"La République" commence par un dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs, Glaucon, Adimante et Thrasymaque, au sujet de la définition de la justice. Thrasymaque soutient que la justice n'est que l'intérêt du plus fort, tandis que Socrate cherche une définition plus approfondie et universelle de la justice.
"La République" est un ouvrage vaste, abordant une multitude de sujets, y compris la nature de la justice, la structure de la cité idéale, l'éducation des gardiens-philosophes, la théorie des idées, la nature de l'âme, la dégénérescence des régimes politiques et même l'immortalité de l'âme.
Une des réflexions les plus célèbres de "La République" est l'allégorie de la caverne, présente dans le livre VII. Platon utilise cette métaphore pour illustrer l'ignorance de l'homme face à la réalité et la nécessité de l'éducation pour accéder à la vérité. Il compare les prisonniers enchaînés dans une caverne, qui ne voient que les ombres projetées sur les murs, à l'homme ignorant, tandis que le monde extérieur, éclairé par le soleil, représente le monde des idées et de la connaissance.
Une citation célèbre de "La République" illustre l'importance de l'éducation dans la construction de la cité idéale :
"Une éducation musicale n'est pas faite pour donner à l'élève les moyens de gagner sa vie, mais pour lui donner le contenu, la mesure, la grâce, en un mot, de faire de lui un homme bien élevé." - Platon, La République, Livre III
Dans "La République," Platon propose également une hiérarchie des âmes, allant des âmes aux désirs les plus bas aux âmes philosophiques les plus élevées. Il décrit la cité idéale comme une tripartition en trois classes : les producteurs (artisans et agriculteurs), les gardiens (soldats) et les philosophes-rois, ces derniers étant les plus aptes à diriger la cité en raison de leur sagesse et de leur connaissance des idées.
"La République" de Platon est une œuvre complexe et riche, explorant des thèmes essentiels tels que la justice, la politique, la connaissance, l'éducation et l'âme humaine. Son impact sur la philosophie politique et la pensée occidentale est indéniable, et ses concepts continuent d'influencer les débats et les réflexions contemporaines sur la société et le gouvernement.
B. Contexte historique et philosophique de l'œuvre "La République"
1. Contexte historique :
"La République" de Platon a été écrit à une période charnière de l'histoire grecque, marquée par des bouleversements politiques et sociaux importants. Platon a vécu à Athènes pendant une époque tumultueuse où la démocratie était remise en question, et où les régimes politiques se succédaient, notamment après la défaite d'Athènes face à Sparte dans la Guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.).
La mort de Socrate, le mentor de Platon, en 399 av. J.-C. a également eu un impact considérable sur la vie de ce dernier. L'exécution de Socrate, accusé de corrompre la jeunesse et de mépriser les dieux, a laissé une marque indélébile sur Platon, qui s'est alors tourné vers la philosophie pour explorer la justice, la morale et la politique.
2. Contexte philosophique :
La pensée philosophique de Platon s'inscrit dans la tradition présocratique, mais il a su innover et développer ses propres idées. Parmi ses influences majeures figurent Héraclite et Parménide, dont les travaux ont nourri ses réflexions sur la nature de la réalité et la quête du savoir.
La philosophie de Platon se caractérise par son idéalisme métaphysique, c'est-à-dire sa conviction que les vérités les plus essentielles sont immatérielles et résident dans le monde des idées (ou Formes). Selon Platon, le monde sensible, que nous percevons par nos sens, n'est que le reflet imparfait des réalités intelligibles et éternelles que sont les Formes.
En outre, Platon a fondé l'Académie, l'une des premières écoles philosophiques de l'Antiquité, vers 387 av. J.-C. Cet établissement a joué un rôle crucial dans la diffusion de ses idées et la formation de nombreux philosophes, dont Aristote.
3. Philosophie politique de Platon dans "La République" :
Dans "La République," Platon présente sa vision idéaliste de la cité juste, Kallipolis, qui devient un modèle de gouvernement et de société. Il critique sévèrement les régimes politiques de son époque, notamment la démocratie, qu'il juge instable et vulnérable aux démagogues et à la tyrannie de la majorité.
Platon estime que la cité idéale doit être dirigée par des gardiens-philosophes, détenteurs de la connaissance des Formes, qui œuvreront pour le bien commun plutôt que pour leurs intérêts personnels. Il prône une société fortement hiérarchisée, où chacun exerce la fonction pour laquelle il est le mieux qualifié, et où l'éducation joue un rôle primordial dans la formation d'individus vertueux et éclairés.
Le contexte historique et philosophique de "La République" de Platon est fondamental pour comprendre l'origine de ses idées et le sens profond de son œuvre. L'instabilité politique d'Athènes et la mort de Socrate ont influencé la pensée de Platon, qui s'est tourné vers la philosophie pour explorer la nature de la justice et la construction de la cité idéale. Sa vision idéaliste et ses concepts novateurs continuent d'inspirer les débats philosophiques et politiques jusqu'à nos jours.
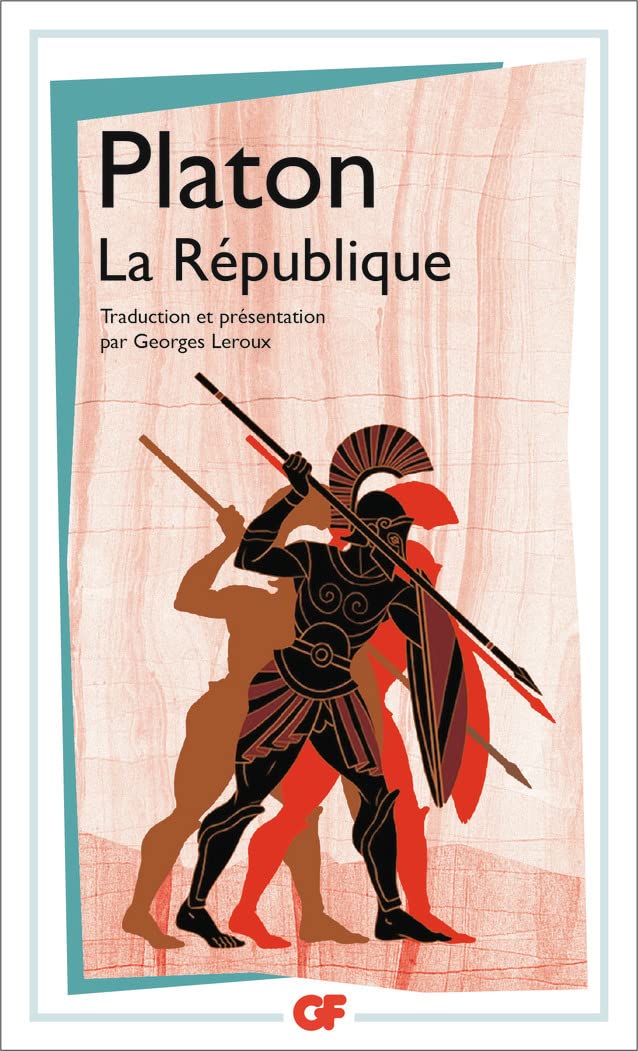
La République
I. Résumé de "La République"
A. Présentation de l'ouvrage "La République" de Platon et de ses personnages principaux
1. Présentation de l'ouvrage :
"La République" est un dialogue philosophique majeur de Platon, composé d'une série de conversations entre Socrate et divers interlocuteurs. L'œuvre se déroule sur une période de dix jours, et chaque livre du dialogue aborde des sujets spécifiques liés à la justice, à la politique, à l'éducation et à la nature de l'âme humaine.
Le dialogue met en évidence la méthode socratique de questionnement, dans laquelle Socrate joue le rôle de l'interrogateur qui pousse ses interlocuteurs à remettre en question leurs propres croyances et à chercher la vérité à travers un processus de raisonnement dialectique.
2. Les personnages principaux :
a. Socrate :
Socrate est le personnage central de "La République." Philosophe emblématique de l'Antiquité, il incarne la figure du sage et du questionneur. Dans le dialogue, Socrate joue le rôle de l'enseignant qui guide ses interlocuteurs dans leur quête de la justice et de la vérité. Il est connu pour sa célèbre maxime : "Je sais que je ne sais rien," exprimant ainsi son humilité intellectuelle et sa recherche constante de la connaissance.
b. Glaucon et Adimante :
Glaucon et Adimante sont les frères de Socrate et font partie des principaux interlocuteurs tout au long du dialogue. Ils représentent les jeunes gens éduqués et intéressés par la politique et la philosophie. Ils sont prompts à remettre en question les idées de Socrate et à participer activement au débat sur la justice et la construction de la cité idéale.
c. Thrasymaque :
Thrasymaque est un sophiste, c'est-à-dire un enseignant itinérant qui propose ses services moyennant rémunération. Dans le dialogue, il incarne l'opposition à la vision de la justice de Socrate. Thrasymaque défend l'idée que la justice n'est rien d'autre que l'intérêt du plus fort et que le pouvoir est synonyme d'injustice. Son intervention initiale lance le débat sur la définition de la justice.
Ces personnages jouent des rôles complémentaires dans "La République" en exprimant des points de vue différents et en participant aux échanges philosophiques avec Socrate. Par leurs discussions, Platon développe ses thèses sur la justice, la politique et la nature humaine.
Il est essentiel de comprendre les interactions entre ces personnages pour apprécier pleinement la richesse des idées et des débats exposés dans "La République." Le dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs donne vie à l'œuvre et permet à Platon d'explorer les multiples facettes de la philosophie et de la pensée politique.
B. Livre I : Le dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs sur la définition de la justice
Le Livre I de "La République" pose les bases du dialogue en introduisant le thème central de l'œuvre : la quête de la définition de la justice. Le dialogue débute dans la maison de Céphale, où Socrate rencontre Glaucon, Adimante et Thrasymaque. Céphale, le père de Polémarque, est également présent au début du dialogue, mais il se retire rapidement de la discussion en raison de son âge avancé.
Socrate, curieux de comprendre la nature de la justice, interroge ses interlocuteurs sur leur vision de la justice. Thrasymaque, le sophiste, prend l'initiative en avançant l'idée que la justice n'est qu'un arrangement social au bénéfice des puissants, un moyen d'exploiter les faibles et de satisfaire leurs désirs. Selon lui, l'injustice est plus avantageuse que la justice.
Thrasymaque déclare : "La justice, c'est l'intérêt du plus fort." - Platon, La République, Livre I
Socrate, en philosophe dialecticien, prend le contre-pied de l'argument de Thrasymaque et réfute cette définition de la justice. Il pousse Thrasymaque à préciser sa pensée et soulève les contradictions de son raisonnement. Socrate souligne qu'il n'est pas toujours évident de déterminer qui est le plus fort, et donc l'intérêt du plus fort ne peut pas être la seule mesure de la justice.
Par la suite, Glaucon prend la parole et propose un défi à Socrate : il demande à ce dernier de démontrer que la justice est intrinsèquement bonne et souhaitable, indépendamment des récompenses et des avantages qu'elle procure. Glaucon pose la célèbre question : "La justice naît-elle de la nécessité ou de l'utilité ?" - Platon, La République, Livre I
Afin de répondre à Glaucon, Socrate entreprend de différencier trois types de biens : les biens désirables en eux-mêmes, les biens désirables à la fois pour eux-mêmes et pour leurs conséquences, et enfin, les biens désirables uniquement pour leurs conséquences.
Au cours de ce dialogue, Platon met en évidence la complexité de la question de la justice et montre que la définition de la justice nécessite une exploration plus approfondie. Le Livre I jette les bases de la réflexion sur la justice et prépare le terrain pour les développements ultérieurs de "La République" où Platon développe sa vision de la justice et explore la construction de la cité idéale.
Le Livre I de "La République" démontre l'importance de la méthode socratique dans l'œuvre de Platon. En utilisant la dialectique, Socrate amène ses interlocuteurs à réfléchir plus profondément sur leurs convictions et à remettre en question les idées reçues. Ce processus de questionnement et de recherche de la vérité est un fil conducteur tout au long de l'œuvre, permettant à Platon d'explorer les différentes facettes de la philosophie et de la politique.
C. Livres II-V : La construction de la cité idéale (Kallipolis) et sa hiérarchie
Dans les Livres II à V de "La République", Platon entame la construction de la cité idéale, également connue sous le nom de Kallipolis, qui devient le modèle de la société juste et bien ordonnée. Pour atteindre cet objectif, Socrate et ses interlocuteurs, en particulier Glaucon et Adimante, poursuivent leur dialogue sur la nature de la justice et cherchent à définir les caractéristiques essentielles de la cité idéale.
1. Les trois classes sociales :
Platon propose une tripartition de la société dans la cité idéale, chacune correspondant à une partie de l'âme humaine. Cette tripartition reflète également l'organisation hiérarchique de la cité et vise à garantir une répartition optimale des fonctions sociales.
a. Les producteurs : Cette classe sociale comprend les artisans, les agriculteurs et tous ceux qui s'occupent des activités économiques nécessaires à la vie quotidienne de la cité. Ils représentent l'appétit de l'âme humaine et sont responsables de la production de biens matériels pour la communauté.
b. Les gardiens : Les gardiens sont les soldats et les défenseurs de la cité. Ils symbolisent la partie courageuse de l'âme, celle qui est prête à se sacrifier pour le bien commun et à défendre la cité contre toute menace extérieure.
c. Les philosophes-rois : Les philosophes-rois sont les détenteurs du savoir et de la sagesse. Ils représentent la raison de l'âme humaine et sont les dirigeants de la cité idéale. Platon insiste sur l'importance de l'éducation pour former des philosophes-rois justes et vertueux, capables de gouverner avec sagesse et bienveillance.
2. Le rôle de l'éducation :
Dans "La République," Platon attribue une grande importance à l'éducation, considérant qu'elle est essentielle pour façonner les individus et la société dans son ensemble. Il insiste sur le fait que l'éducation doit être soigneusement contrôlée et organisée dès le plus jeune âge. Les gardiens et les philosophes-rois doivent suivre un processus d'éducation rigoureux qui comprend une formation dans les arts, les sciences, la musique et la gymnastique.
Platon défend l'idée que la musique et la poésie doivent être réglementées dans la cité idéale, car elles ont un impact direct sur l'âme et peuvent influencer les valeurs et les comportements des citoyens. Seule une éducation adéquate permettra de cultiver la vertu et de former des dirigeants justes et éclairés.
3. Le mythe des métaux :
Platon présente également le mythe des métaux dans le Livre III de "La République". Ce mythe est utilisé pour justifier la hiérarchie sociale et pour légitimer la position des philosophes-rois en tant que dirigeants de la cité. Selon le mythe, les citoyens sont nés avec différents métaux dans leur âme : les philosophes-rois ont de l'or dans leur âme, les gardiens de l'argent et les producteurs du bronze. Cette différenciation naturelle justifie le rôle de chaque classe sociale dans la cité et renforce l'idée que chacun doit occuper la fonction pour laquelle il est le mieux adapté.
En conclusion, les Livres II à V de "La République" décrivent la construction de la cité idéale, Kallipolis, selon une tripartition sociale et une hiérarchie fondée sur les vertus de l'âme humaine. Platon souligne l'importance de l'éducation pour former des citoyens vertueux et des dirigeants éclairés. Cette construction de la cité idéale pose les bases de la réflexion politique et sociale de Platon, dans laquelle il explore les principes fondamentaux de la justice et du gouvernement idéal.
D. Livres VI-VII : L'allégorie de la caverne et l'éducation des gardiens-philosophes
Dans les Livres VI et VII de "La République", Platon approfondit la formation des gardiens-philosophes, la classe dirigeante de la cité idéale, et présente l'allégorie de la caverne, l'une des métaphores les plus célèbres de l'histoire de la philosophie.
1. L'éducation des gardiens-philosophes :
Platon insiste sur l'importance de l'éducation pour former des gardiens-philosophes justes et vertueux. Il affirme que les futurs dirigeants doivent suivre une éducation spécifique qui les amène à découvrir les réalités intellectuelles et à développer leur raison, tout en étant formés à se détourner des tentations matérielles et égoïstes.
L'éducation des gardiens-philosophes est basée sur un régime strict qui comprend un contrôle absolu sur les œuvres artistiques et poétiques, visant à éliminer tout élément susceptible de corrompre les valeurs de la cité idéale. La musique et les récits doivent être conformes à l'éthique et contribuer à former des citoyens justes et moraux.
2. L'allégorie de la caverne :
L'allégorie de la caverne est présentée dans le Livre VII de "La République" et est l'un des moments les plus marquants de l'œuvre. Platon utilise cette métaphore pour illustrer la distinction entre le monde sensible, perçu par nos sens, et le monde des idées ou Formes, qui représente la réalité intellectuelle et éternelle.
Dans l'allégorie, Platon décrit des hommes enchaînés depuis leur enfance dans une caverne, face à un mur sur lequel sont projetées des ombres. Ces ombres sont les seules images que les prisonniers connaissent, et ils les prennent pour la réalité. Un prisonnier est ensuite libéré et forcé de sortir de la caverne, découvrant ainsi le monde extérieur éclairé par le soleil. Initialement ébloui par la lumière, il finit par s'habituer à la réalité et réalise la vérité des ombres dans la caverne.
Cette allégorie exprime la notion platonicienne selon laquelle le monde sensible est une réalité imparfaite et éphémère, tandis que le monde des idées est le véritable domaine de la connaissance et de la vérité. Les gardiens-philosophes, éduqués dans la contemplation des Formes, devraient être les guides de la cité en raison de leur accès à la connaissance la plus élevée.
3. La formation des dirigeants justes :
Pour Platon, la formation des dirigeants justes est essentielle pour maintenir l'harmonie et la stabilité de la cité idéale. Les gardiens-philosophes, en cultivant leur raison et en se tournant vers le monde des idées, développent leur vertu et leur capacité à gouverner pour le bien commun.
Platon souligne que les dirigeants justes doivent mettre en œuvre la philosophie dans leur vie quotidienne et ne pas chercher le pouvoir pour leur intérêt personnel. Seuls ceux qui sont détachés des désirs matériels et qui se préoccupent du bien-être de la cité sont qualifiés pour devenir des philosophes-rois.
Les Livres VI et VII de "La République" approfondissent l'éducation des gardiens-philosophes et mettent en lumière l'allégorie de la caverne pour illustrer la distinction entre le monde sensible et le monde des idées. La formation des dirigeants justes et éclairés est au cœur de la vision politique de Platon, affirmant que seuls les philosophes-rois, formés à contempler les réalités intellectuelles, peuvent gouverner la cité idéale avec sagesse et justice.
E. Livres VIII-IX : La dégénérescence de la cité idéale et les régimes politiques dégradés
Dans les Livres VIII et IX de "La République", Platon explore le thème de la dégénérescence de la cité idéale, Kallipolis, et expose la succession des régimes politiques dégradés qui peuvent émerger lorsque les principes de justice et de vertu sont compromis.
1. La dégénérescence de la cité idéale :
Platon reconnaît que la cité idéale, malgré son excellence et sa conception juste, est une construction idéale qui n'existe pas dans le monde réel. Il reconnaît que, avec le temps, même la cité idéale pourrait être sujette à la corruption et à la dégénérescence. Les citoyens pourraient succomber aux tentations du pouvoir, de l'argent et du plaisir, entraînant ainsi la perte de la justice et de la vertu qui caractérisaient la cité idéale à l'origine.
2. Les régimes politiques dégradés :
Platon décrit la succession des régimes politiques dégradés qui peuvent remplacer la cité idéale. Ces régimes se détériorent progressivement en passant d'une forme de gouvernement à l'autre, reflétant également la dégradation des âmes individuelles et de la société dans son ensemble.
a. Timocratie : Ce régime politique est caractérisé par l'amour de l'honneur et de la gloire. Il succède à la cité idéale lorsque les gardiens-philosophes deviennent avides de gloire et de reconnaissance, plutôt que de se concentrer sur la recherche de la vérité et du bien commun.
b. Oligarchie : L'oligarchie émerge lorsque les dirigeants de la cité idéale deviennent obsédés par l'accumulation de richesses matérielles et cherchent à protéger leurs intérêts financiers. La recherche du profit personnel remplace alors le souci du bien-être collectif.
c. Démocratie : La démocratie se manifeste lorsque la quête de liberté individuelle et de plaisir devient prépondérante. Les citoyens aspirent à une vie dépourvue de contraintes et de responsabilités, entraînant une instabilité politique et sociale.
d. Tyrannie : Le pire régime politique est la tyrannie, où un individu ambitieux et sans scrupules prend le pouvoir et gouverne avec une main de fer, souvent au détriment de la liberté et de la justice. La tyrannie est l'aboutissement ultime de la dégénérescence politique et sociale.
3. Le parallèle avec l'âme individuelle :
Platon établit un parallèle entre les régimes politiques dégradés et les différentes parties de l'âme individuelle. Chaque régime reflète les passions et les vices qui peuvent envahir l'âme humaine lorsque les principes de justice, de modération et de sagesse sont négligés.
En exposant la dégénérescence de la cité idéale et des régimes politiques dégradés, Platon souligne l'importance de préserver la vertu et la justice au sein de la cité et de cultiver l'âme individuelle. Il met en garde contre les dangers de l'avidité, du pouvoir excessif et de la poursuite du plaisir personnel, qui peuvent mener à la destruction de la société et à l'effondrement des valeurs morales.
Les Livres VIII et IX de "La République" décrivent la dégénérescence de la cité idéale et exposent la succession des régimes politiques dégradés qui peuvent émerger lorsque les principes de justice et de vertu sont ignorés. Platon utilise cette analyse politique pour souligner l'importance de préserver les valeurs morales et de cultiver l'âme individuelle, afin de garantir la stabilité et la justice dans la société.
F. Livre X : Le mythe d'Er et la réflexion sur l'immortalité de l'âme
Dans le Livre X de "La République", Platon présente le mythe d'Er, une histoire fantastique racontée par Socrate qui soulève des questions profondes sur l'immortalité de l'âme et sur la nature de la justice et de la récompense après la mort.
1. Le mythe d'Er :
Le mythe d'Er est raconté par Socrate à la fin du dialogue, dans lequel il relate une expérience extraordinaire vécue par un guerrier mort sur le champ de bataille, nommé Er. L'âme d'Er quitte son corps, mais au lieu de traverser le fleuve du Styx pour rejoindre le royaume des morts, elle est ramenée à la vie après douze jours.
Er raconte alors son voyage dans l'au-delà, où il observe le jugement des âmes et les récompenses et châtiments accordés en fonction des actions accomplies au cours de leur vie terrestre. Les âmes vertueuses sont récompensées et choisissent une nouvelle vie, tandis que les âmes injustes subissent des châtiments adaptés à leurs méfaits.
2. Réflexion sur l'immortalité de l'âme :
Le mythe d'Er suscite une réflexion profonde sur l'immortalité de l'âme et la croyance en une vie après la mort. Platon souligne que l'âme est éternelle et qu'elle continue d'exister au-delà de la mort du corps. Selon lui, la justice prévaut dans l'au-delà, et chaque âme est rétribuée en fonction de ses actions vertueuses ou injustes dans la vie terrestre.
Platon soutient que la quête de la justice et de la vertu n'est pas seulement une affaire terrestre, mais aussi une préoccupation de l'âme éternelle. Les individus doivent cultiver leur âme et poursuivre la connaissance et la sagesse pour atteindre la vérité et la justice, car cela aura des conséquences durables au-delà de cette vie.
3. Conséquences pour la cité idéale :
Le mythe d'Er a également des implications pour la cité idéale, Kallipolis. Platon souligne que les citoyens doivent être éduqués dans la justice et la vertu dès leur plus jeune âge, car cela influencera le caractère de leur âme et, par conséquent, leur comportement dans la cité. La quête de la sagesse et de la vérité est un idéal constant pour les gardiens-philosophes, car cela garantira leur capacité à gouverner justement et à préserver l'harmonie de la cité idéale.
En présentant le mythe d'Er, Platon aborde des questions fondamentales concernant la nature de l'âme et l'existence d'une vie après la mort. Ce récit mythologique renforce les idées platoniciennes sur l'importance de la vertu, de la justice et de la sagesse dans la vie humaine et dans la construction d'une société juste et harmonieuse.
Le Livre X de "La République" présente le mythe d'Er, qui soulève des interrogations profondes sur l'immortalité de l'âme et la justice dans l'au-delà. Platon insiste sur l'importance de cultiver l'âme et de poursuivre la sagesse et la vertu, car cela a des implications durables sur le destin des individus et de la cité idéale. Le mythe d'Er clôture magistralement cette œuvre majeure de la philosophie antique, offrant ainsi une réflexion complète et complexe sur la justice, la politique et la nature humaine.
II. Analyse de "La République"
A. La quête de la justice : une exploration philosophique
1. La dialectique socratique au service de la recherche de la vérité
La dialectique socratique est au cœur de "La République" de Platon. Tout au long du dialogue, Socrate utilise cette méthode de questionnement pour guider ses interlocuteurs vers la recherche de la vérité et de la justice. La dialectique socratique est un processus de raisonnement et d'examen critique qui permet de mettre en lumière les contradictions et les lacunes dans la pensée des individus, les incitant ainsi à remettre en question leurs croyances et à parvenir à des conclusions plus solides.
1.1 La méthode socratique de questionnement :
Socrate se présente comme un "accoucheur des âmes", qui aide ses interlocuteurs à accoucher de leurs idées et de leurs opinions, les conduisant à une prise de conscience plus profonde de la vérité. Il pose des questions simples et directes pour explorer les concepts et les arguments, poussant ainsi ses interlocuteurs à clarifier leurs pensées et à définir leurs positions.
Socrate n'impose pas ses propres opinions, mais il fait office de guide pour inciter ses interlocuteurs à se remettre en question, à confronter leurs idées aux objections et à développer des arguments plus solides. Par ce processus de dialogue, la vérité émerge progressivement, permettant ainsi aux participants d'accéder à une meilleure compréhension des questions philosophiques abordées dans l'œuvre.
1.2 Le rôle de la dialectique dans "La République" :
Dans "La République", Platon utilise la dialectique socratique pour explorer des questions essentielles sur la justice, la vertu, le gouvernement et la nature humaine. Les dialogues entre Socrate et ses interlocuteurs constituent un moyen pour Platon de présenter ses propres idées philosophiques et de critiquer les opinions répandues de son époque.
Par exemple, dans le Livre I, la discussion entre Socrate et Thrasymaque sur la définition de la justice conduit à une remise en question de l'idée selon laquelle la justice serait simplement l'intérêt du plus fort. Socrate soulève des objections et montre les limites de cette définition, ouvrant ainsi la voie à un examen plus approfondi de la justice dans les livres suivants.
1.3 L'objectif de la dialectique :
L'objectif ultime de la dialectique socratique dans "La République" est de parvenir à une meilleure compréhension de la justice et de la nature de la cité idéale. Platon souhaite montrer que la justice n'est pas seulement une question de convention sociale ou de pouvoir, mais qu'elle repose sur des principes universels et éternels qui se reflètent dans le monde des idées.
La dialectique permet à Platon de démontrer que les régimes politiques dégradés sont en réalité des manifestations de l'âme humaine déviante, qui cherche à satisfaire ses désirs égoïstes plutôt que de rechercher le bien commun. En confrontant les interlocuteurs de Socrate à des contradictions et en les amenant à réfléchir plus profondément, Platon dévoile les causes de la dégénérescence politique et souligne l'importance de cultiver la vertu et la sagesse pour construire une cité juste et harmonieuse.
La dialectique socratique est un outil essentiel dans "La République" de Platon pour mener une enquête philosophique approfondie sur la vérité et la justice. Socrate, en tant que personnage central du dialogue, utilise cette méthode de questionnement pour guider ses interlocuteurs vers une meilleure compréhension des questions politiques, morales et métaphysiques abordées dans l'œuvre. La dialectique socratique incite les individus à remettre en question leurs croyances, à explorer les contradictions dans leur pensée et à chercher la vérité au-delà des apparences.
2. La définition de la justice selon Platon
La définition de la justice est l'un des thèmes centraux de "La République" de Platon. Tout au long du dialogue, Socrate et ses interlocuteurs cherchent à définir la justice et à comprendre sa nature profonde. Platon propose une conception complexe de la justice, en la situant à la fois dans la cité idéale (Kallipolis) et dans l'âme individuelle.
2.1 La justice dans la cité idéale (Kallipolis) :
Platon considère que la justice est la vertu cardinale qui guide l'organisation harmonieuse de la cité idéale. Il définit la justice dans la cité comme une situation où chaque classe sociale remplit son rôle propre sans empiéter sur les fonctions des autres. La tripartition de la société en producteurs, gardiens et philosophes-rois reflète la tripartition de l'âme individuelle en appétit, courage et raison.
La justice dans la cité idéale implique que chaque individu joue son rôle de manière vertueuse, en exerçant ses compétences et ses talents pour le bien de la communauté. Les gardiens assurent la protection de la cité et respectent les principes de la modération et du courage, tandis que les philosophes-rois gouvernent en ayant pour objectif le bien-être de tous.
2.2 La justice dans l'âme individuelle :
Platon établit un parallèle entre la justice dans la cité idéale et la justice dans l'âme individuelle. Selon lui, l'âme humaine est également tripartite, composée de trois parties : l'appétit, le courage et la raison. La justice de l'âme consiste à ce que chaque partie remplisse son rôle de manière harmonieuse et coordonnée.
La partie appétitive de l'âme représente les désirs et les instincts humains. La partie courageuse est responsable de la volonté et de la détermination face aux défis et aux dangers. Enfin, la partie rationnelle est associée à la raison, à la sagesse et au discernement.
La justice de l'âme consiste à ce que la partie rationnelle gouverne et guide les parties appétitives et courageuses. Lorsque la raison est en contrôle, l'âme est en harmonie, et les désirs sont maîtrisés par la sagesse, conduisant ainsi l'individu à agir vertueusement.
2.3 La recherche de la justice :
Dans "La République," Platon présente différentes conceptions de la justice proposées par ses interlocuteurs. Thrasymaque défend l'idée que la justice est l'intérêt du plus fort, tandis que Glaucon demande à Socrate de prouver que la justice est intrinsèquement désirable, indépendamment des récompenses qu'elle offre.
Au fur et à mesure du dialogue, Platon réfute ces définitions de la justice et propose sa propre conception, en soulignant que la justice n'est pas seulement une question d'intérêt ou de récompense, mais qu'elle est liée à l'idée du bien suprême. La justice est la clé pour atteindre la vertu et pour réaliser le plein potentiel de l'âme individuelle et de la cité.
La définition de la justice selon Platon est complexe et profonde. La justice est la vertu fondamentale qui guide l'organisation harmonieuse de la cité idéale et de l'âme individuelle. Elle implique l'accomplissement de chaque fonction dans la société et dans l'âme de manière vertueuse, en respectant les principes de la modération, du courage et de la raison. La recherche de la justice est au cœur du dialogue de "La République", mettant en évidence la quête de Platon pour comprendre les fondements de la morale et de la politique idéales.
3. La justice individuelle et la justice dans la cité idéale
Dans "La République" de Platon, la justice individuelle est étroitement liée à la justice dans la cité idéale (Kallipolis). Platon explore comment ces deux formes de justice sont intimement liées et comment elles se reflètent l'une dans l'autre.
3.1 La justice individuelle :
Platon soutient que la justice individuelle est le reflet de la justice dans la cité. Comme l'âme humaine est tripartite, composée des parties appétitive, courageuse et rationnelle, la justice individuelle consiste à ce que ces parties fonctionnent harmonieusement, avec la partie rationnelle gouvernant les parties inférieures.
Lorsque la raison dirige l'âme, les désirs et les instincts sont maîtrisés par la sagesse, et l'individu agit vertueusement. La justice individuelle implique que chaque personne assume son rôle et ses responsabilités dans la société de manière éthique, contribuant ainsi au bien-être de la communauté.
3.2 La justice dans la cité idéale :
La justice dans la cité idéale reflète l'organisation harmonieuse de l'âme individuelle. Platon propose que la tripartition de la cité en producteurs, gardiens et philosophes-rois corresponde à la tripartition de l'âme en appétit, courage et raison.
Dans la cité idéale, la justice consiste à ce que chaque classe sociale remplisse son rôle de manière juste, sans empiéter sur les fonctions des autres. Les producteurs produisent les biens nécessaires à la vie de la cité, les gardiens assurent la défense et la protection, tandis que les philosophes-rois gouvernent avec sagesse pour le bien commun.
La cité idéale est un modèle de justice, où chacun travaille en harmonie pour le bien de la communauté dans son ensemble. La recherche du bien commun prévaut sur les intérêts individuels, et le gouvernement est basé sur la connaissance, la sagesse et la vertu.
3.3 L'interdépendance entre la justice individuelle et la justice dans la cité idéale :
Platon souligne que la justice individuelle est essentielle pour atteindre la justice dans la cité idéale. Les gardiens-philosophes, qui gouvernent la cité idéale, doivent cultiver leur âme et rechercher la sagesse et la vertu pour être de justes dirigeants.
De même, la cité idéale, en tant que modèle de justice, doit fournir le cadre et les institutions nécessaires pour cultiver la justice individuelle chez ses citoyens. L'éducation joue un rôle primordial dans la formation de citoyens justes et vertueux, capables de remplir leurs fonctions sociales de manière éthique.
Platon souligne également que la justice individuelle et la justice dans la cité idéale sont interdépendantes et s'influencent mutuellement. L'individu vertueux contribue à la justice de la cité, tandis qu'une cité juste favorise le développement de la justice individuelle chez ses citoyens.
Dans "La République" de Platon, la justice individuelle et la justice dans la cité idéale sont étroitement liées et se reflètent l'une dans l'autre. La tripartition de l'âme individuelle trouve son équivalent dans la tripartition de la cité idéale, et la recherche de la justice individuelle est essentielle pour atteindre la justice dans la cité. Platon insiste sur l'importance de cultiver la vertu et la sagesse à la fois au niveau individuel et collectif pour construire une société juste et harmonieuse.
B. La cité idéale de Platon : Kallipolis
1. Les trois classes sociales et la justice dans la cité
Les trois classes sociales et la justice dans la cité sont au cœur de la réflexion de Platon dans "La République". Voici quelques citations clés qui illustrent leur rôle et leur importance dans l'organisation de la cité idéale :
1. Les producteurs :
Les producteurs, représentant l'appétit de l'âme humaine, sont responsables de la production des biens nécessaires à la vie de la cité. Ils sont considérés comme la classe la plus nombreuse et la moins privilégiée. Platon met l'accent sur leur fonction vitale dans la cité et la nécessité qu'ils remplissent leur rôle avec vertu et modération :
"Les producteurs nous fourniront donc, de leurs terres, l'essentiel de leur récolte, et ce n'est pas pour qu'ils recherchent les biens d'autrui ni qu'ils en soient les débiteurs." (La République, Livre II)
2. Les gardiens :
Les gardiens, représentant la partie courageuse de l'âme, sont les soldats et les défenseurs de la cité. Ils sont éduqués dans la discipline et la maîtrise de soi pour protéger la cité des menaces extérieures et internes. Platon insiste sur la nécessité que les gardiens soient élevés dans la vertu et la justice :
"Ces hommes-là donc, nés et élevés dans des conditions appropriées, il faudra les désigner pour garder la cité, chacun d'eux étant choisi pour sa nature et son éducation, parmi ceux qui se sont montrés les meilleurs à l'exercice de la guerre." (La République, Livre III)
3. Les philosophes-rois :
Les philosophes-rois, représentant la raison de l'âme, sont les dirigeants éclairés de la cité. Ils doivent être détenteurs du savoir et de la sagesse, capables de gouverner avec justice et bienveillance. Platon insiste sur l'importance de leur éducation et de leur formation :
"J'affirme que le seul pouvoir auquel appartient la philosophie d'amener ces hommes-là à être philosophes-rois, ou ceux que nous considérerons comme capables de le devenir." (La République, Livre VI)
En résumé, les trois classes sociales dans la cité idéale reflètent les trois parties de l'âme humaine et leur tripartition permet d'établir une organisation harmonieuse de la cité. Les producteurs, les gardiens et les philosophes-rois doivent remplir leurs fonctions avec justice et vertu, contribuant ainsi à la recherche de la justice dans la cité idéale. Platon insiste sur l'importance de l'éducation et de la formation des gardiens et des philosophes-rois pour garantir le bon fonctionnement de la cité et le bien-être de ses citoyens.
2. Le rôle des gardiens-philosophes et leur éducation
Dans "La République" de Platon, les gardiens-philosophes jouent un rôle crucial dans la cité idéale (Kallipolis). Ils sont la classe dirigeante et doivent posséder des qualités spécifiques pour gouverner justement et sagement. Leur éducation est conçue pour les préparer à assumer cette responsabilité avec sagesse et vertu.
1. Le rôle des gardiens-philosophes :
Les gardiens-philosophes sont les dirigeants éclairés de la cité idéale. Ils sont choisis parmi les meilleurs et les plus vertueux des citoyens, non pas en raison de leur naissance ou de leur richesse, mais en fonction de leurs qualités intellectuelles et morales. Leur mission est de veiller au bien-être de la cité et de garantir la justice et l'harmonie au sein de la société.
Les gardiens-philosophes sont les gardiens de la loi et des principes moraux. Ils sont censés gouverner avec modération et courage, en rejetant les désirs égoïstes et en plaçant l'intérêt commun au-dessus de leurs propres intérêts. Leur autorité est basée sur la sagesse et la connaissance des principes éternels de la justice.
2. L'éducation des gardiens-philosophes :
L'éducation des gardiens-philosophes est rigoureuse et spécialement conçue pour cultiver en eux les vertus nécessaires pour gouverner avec sagesse. Ils sont élevés dans un environnement où la recherche de la vérité et la contemplation des idées sont privilégiées. Leur éducation vise à développer leur âme vers l'amour de la sagesse et à les détourner des tentations matérielles.
L'éducation des gardiens-philosophes comprend trois étapes importantes :
a. L'éducation musicale : Elle ne concerne pas seulement la musique, mais aussi la poésie et les récits. Platon insiste sur l'importance de contrôler le contenu des œuvres artistiques et poétiques afin d'éliminer toute représentation de comportements immoraux. Les gardiens-philosophes doivent être exposés uniquement à des œuvres qui nourrissent leur âme vers la vertu et la sagesse.
b. L'éducation physique : Les gardiens-philosophes reçoivent une éducation physique rigoureuse pour développer leur force et leur résistance. Cela leur permettra d'être prêts à défendre la cité et à résister aux dangers qui pourraient menacer son intégrité.
c. L'éducation intellectuelle : Cette étape vise à développer leur capacité de raisonnement et à les initier à la philosophie. Les gardiens-philosophes doivent apprendre à contempler les idées et les Formes éternelles, ce qui les guidera dans leur prise de décision et dans la formulation des lois pour la cité.
3. L'importance de la formation des gardiens-philosophes :
Pour Platon, l'éducation des gardiens-philosophes est essentielle pour assurer la stabilité et la justice dans la cité idéale. Seuls les dirigeants vertueux et éclairés, formés dans la contemplation des réalités intellectuelles, peuvent gouverner avec sagesse et veiller au bien-être de tous les citoyens.
Platon insiste sur le fait que les gardiens-philosophes doivent être détachés des désirs matériels et égoïstes, car leur rôle exige qu'ils sacrifient leurs intérêts personnels pour le bien commun. Leur éducation vise à cultiver l'amour de la sagesse et à les guider vers une vie de vertu et de dévouement à la cité.
Les gardiens-philosophes jouent un rôle fondamental dans la cité idéale de Platon, en tant que classe dirigeante éclairée. Leur éducation rigoureuse et leur formation dans la contemplation des idées sont essentielles pour leur permettre de gouverner avec sagesse et de garantir la justice et l'harmonie dans la cité. Platon insiste sur l'importance de choisir des dirigeants vertueux et qualifiés, capables de mettre en œuvre la philosophie dans leur gouvernance pour le bien-être de tous les citoyens.
3. L'allégorie de la caverne : de l'ignorance à la connaissance
L'allégorie de la caverne est l'une des métaphores les plus célèbres et les plus influentes de "La République". Elle apparaît dans le Livre VII et illustre le cheminement de l'ignorance vers la connaissance et la réalisation de la vérité. Cette allégorie est une puissante représentation de la philosophie de Platon et de sa vision de l'éducation comme moyen de sortir de l'illusion et d'accéder à la connaissance supérieure.
1. Le contexte de l'allégorie :
Dans l'allégorie de la caverne, Platon compare l'expérience humaine à celle d'un groupe de prisonniers enchaînés dans une caverne depuis leur naissance, face à un mur. Derrière eux, un feu projette des ombres des objets passant devant lui sur le mur. Les prisonniers ne peuvent voir que ces ombres et prennent ces illusions pour la réalité.
2. Le cheminement vers la connaissance :
Un des prisonniers est libéré et contraint de se tourner vers la lumière du feu, ce qui lui provoque d'abord des douleurs et une désorientation. Il parvient ensuite à regarder directement le feu, puis à contempler les objets réels qui projettent les ombres. Ce prisonnier représente le philosophe qui s'efforce de comprendre la véritable nature de la réalité.
Après avoir contemplé les objets réels, le philosophe est amené à sortir de la caverne et à affronter la lumière du soleil à l'extérieur. Ce processus est difficile et douloureux, car les yeux du philosophe ne sont pas habitués à la lumière éblouissante du soleil, mais finalement, il peut voir le monde tel qu'il est réellement.
3. La révélation de la vérité :
Une fois que le philosophe a acquis la connaissance et la compréhension de la réalité, il retourne dans la caverne pour libérer ses compagnons enchaînés. Cependant, les autres prisonniers ne comprennent pas ce qu'il leur dit, car ils n'ont jamais connu autre chose que les ombres. Ils refusent de croire en la réalité extérieure et considèrent le philosophe comme fou.
Cette partie de l'allégorie exprime les défis auxquels le philosophe est confronté lorsqu'il tente de partager la vérité avec ceux qui sont restés dans l'ignorance. La philosophie et la quête de la connaissance peuvent être solitaires et incomprises, car la plupart des gens sont attachés à leurs croyances et ne veulent pas remettre en question leur vision du monde.
4. L'importance de l'éducation :
L'allégorie de la caverne souligne l'importance de l'éducation comme moyen de sortir de l'ignorance et d'accéder à la connaissance. Les prisonniers enchaînés dans la caverne représentent l'ignorance et les illusions du monde sensible, tandis que le philosophe qui émerge de la caverne représente la quête de la vérité et de la sagesse.
Pour Platon, l'éducation doit viser à libérer l'âme des chaînes de l'ignorance et à la guider vers la contemplation des réalités éternelles et des idées. L'éducation permet de transcender le monde des apparences et de parvenir à la connaissance de la réalité suprême.
L'allégorie de la caverne de "La République" de Platon est une puissante représentation de la quête de la connaissance et de la vérité. Elle souligne l'importance de l'éducation pour libérer l'âme de l'ignorance et pour accéder à la contemplation des idées éternelles. L'allégorie de la caverne reste un symbole intemporel de la philosophie de Platon et de sa conviction que la philosophie peut conduire l'individu vers une compréhension plus profonde du monde et de soi-même.
C. La dégénérescence des régimes politiques
1. La critique des régimes politiques dégradés : oligarchie, démocratie, tyrannie
Dans "La République", Platon critique les régimes politiques dégradés qui émergent de la dégénérescence des cités et qui correspondent aux déformations des âmes individuelles. Ces régimes sont l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Platon met en évidence les dangers et les faiblesses inhérents à ces formes de gouvernement, soulignant ainsi l'importance de cultiver la vertu et la justice pour prévenir leur apparition.
1. L'oligarchie :
L'oligarchie est un régime politique caractérisé par le pouvoir détenu par une minorité de riches et de puissants. Platon critique l'oligarchie en mettant en avant le fait que cette classe dirigeante est motivée par l'amour de l'argent et de la richesse. Leur recherche du profit personnel les conduit à négliger l'intérêt commun et à gouverner de manière égoïste, générant ainsi l'injustice et la division dans la cité.
"L'oligarchie se forme quand on se soucie plus de l'argent qu'on n'aurait dû." (La République, Livre VIII)
2. La démocratie :
La démocratie est un régime politique où le pouvoir est exercé par la majorité des citoyens. Platon critique la démocratie en soulignant qu'elle favorise la liberté individuelle au détriment de l'ordre et de la stabilité. Les citoyens peuvent être gouvernés par leurs désirs et leurs passions, ce qui conduit à l'anarchie et à l'instabilité politique. Platon considère que la démocratie est encline à engendrer des tyrans qui exploitent le mécontentement populaire et s'emparent du pouvoir.
"Et voici le dernier régime, qui peut être la forme dégénérée de l'oligarchie quand elle se prolonge, et qui s'appelle démocratie." (La République, Livre VIII)
3. La tyrannie :
La tyrannie est le régime politique le plus dégradé selon Platon. Elle émerge lorsque les citoyens succombent à leurs désirs et à leurs passions, et lorsqu'ils désirent ardemment un leader fort pour mettre fin au chaos et à l'instabilité. Cependant, le tyran n'a pas l'intérêt de la cité à cœur et gouverne pour satisfaire ses propres désirs. La tyrannie est caractérisée par l'oppression, la corruption et l'injustice, et elle conduit à la dégradation morale et sociale de la cité.
"Et c'est dans ce régime-là que naissent, à mon avis, les tyrans." (La République, Livre VIII)
4. La quête de la justice :
Face à ces régimes politiques dégradés, Platon insiste sur l'importance de la justice comme fondement de la cité idéale. Pour éviter la dégénérescence politique et sociale, il est essentiel de cultiver la vertu et la sagesse chez les dirigeants et les citoyens. La cité idéale de Kallipolis repose sur une tripartition harmonieuse de la société, où chaque classe sociale remplit son rôle avec justice et dévouement pour le bien commun.
Dans "La République", Platon critique les régimes politiques dégradés tels que l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Il souligne les dangers de l'égoïsme, de l'anarchie et de l'oppression qui peuvent émerger de ces formes de gouvernement. Platon met en avant l'importance de la justice, de la vertu et de la sagesse pour prévenir la dégénérescence politique et sociale, et pour construire une cité juste et harmonieuse. La quête de la justice et la cultivation de la vertu demeurent des idéaux centraux dans la philosophie politique de Platon.
2. Le parallèle entre l'âme individuelle et la cité dans leur déclin
Dans "La République", Platon établit un parallèle profond entre l'âme individuelle et la cité, montrant comment leur déclin peut conduire à des régimes politiques dégradés et à la corruption morale. Ce parallèle met en évidence l'interconnexion entre l'état de l'âme des individus et l'état de la société dans son ensemble.
1. Le déclin de l'âme individuelle :
Platon décrit comment l'âme individuelle peut se dégrader en passant d'un état de vertu et d'harmonie à un état de déchéance morale. L'âme tripartite, composée de l'appétit, du courage et de la raison, peut être déséquilibrée lorsque l'appétit domine la raison et le courage. Lorsque les désirs égoïstes et les passions prennent le dessus sur la sagesse et la modération, l'âme devient désordonnée et instable.
Ce déclin de l'âme individuelle peut entraîner l'émergence de vices tels que la cupidité, l'avidité, la colère et la vanité. L'individu devient alors esclave de ses propres désirs et ne peut plus agir de manière juste et vertueuse. Le manque de contrôle sur les désirs mène à une vie de désordre et de conflits internes.
2. Le déclin de la cité :
Le déclin de la cité suit un schéma similaire à celui de l'âme individuelle. Lorsque les citoyens de la cité se laissent guider par leurs intérêts personnels et leurs désirs égoïstes, la cité se trouve dans un état de désordre et de division. Les classes sociales deviennent compétitives et cherchent à préserver leurs propres intérêts au détriment du bien commun.
Ce déclin moral de la cité mène à l'émergence de régimes politiques dégradés tels que l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Les dirigeants corrompus gouvernent pour leur propre bénéfice et non pour le bien de la communauté. L'injustice, la division sociale et la violence prévalent dans la cité, conduisant à sa dégénérescence.
3. L'interrelation entre l'âme individuelle et la cité :
Le parallèle entre l'âme individuelle et la cité montre comment le déclin moral de l'une peut avoir des répercussions sur l'autre. Lorsque les individus deviennent égoïstes et corrompus, la société dans son ensemble devient également corrompue. De même, une société dégénérée peut influencer négativement les individus et altérer leur propre moralité.
Platon insiste sur l'importance de cultiver la vertu et la justice chez les individus pour préserver l'harmonie sociale dans la cité. La quête de la sagesse et de la vertu, tant au niveau individuel que collectif, est essentielle pour empêcher la dégénérescence morale et politique.
Le parallèle entre l'âme individuelle et la cité dans leur déclin met en lumière l'interconnexion étroite entre l'état de l'individu et celui de la société. Platon souligne l'importance de cultiver la vertu, la modération et la sagesse chez les individus pour prévenir la dégénérescence morale de la cité et pour construire une société juste et harmonieuse. Ce parallèle renforce l'idée que la quête de la justice et de la vertu est un idéal fondamental tant au niveau personnel que politique.
D. Le mythe d'Er et la question de l'immortalité de l'âme
1. La fonction du mythe dans la pensée platonicienne
Le mythe joue un rôle essentiel dans la pensée platonicienne, en particulier dans "La République". Platon utilise le mythe comme un outil puissant pour communiquer des idées complexes et abstraites d'une manière accessible et captivante. Les mythes permettent à Platon d'exprimer des vérités philosophiques profondes tout en suscitant l'imagination et l'émotion de ses lecteurs. Voici les principales fonctions du mythe dans la pensée platonicienne :
1.1. Accès à la vérité métaphysique :
Platon considère que certaines vérités métaphysiques, telles que les idées et les Formes, ne peuvent être pleinement comprises par la raison ou l'intellect seul. Les mythes, en revanche, peuvent fournir un moyen d'accéder à ces vérités au niveau émotionnel et intuitif. Les mythes aident à saisir des concepts abstraits en les personnifiant ou en les présentant sous forme d'histoires narratives.
1.2. Explication des principes moraux et éthiques :
Les mythes sont utilisés pour expliquer et renforcer les principes moraux et éthiques. Par exemple, l'allégorie de l'anneau de Gygès dans "La République" met en évidence la question de la justice et de la moralité, en explorant si l'individu agirait différemment s'il était totalement invisible et qu'il pouvait faire ce qu'il veut sans être tenu responsable.
1.3. Communication de la pensée philosophique :
Platon utilise les mythes pour transmettre ses idées philosophiques d'une manière accessible à un large public. Les mythes sont des récits vivants qui engagent les émotions et l'imagination du lecteur, facilitant ainsi une meilleure compréhension des concepts philosophiques complexes.
1.4. Éveil de la pensée critique :
Les mythes de Platon peuvent être ambigus et sujets à interprétation. En suscitant la réflexion et le débat, les mythes encouragent les lecteurs à s'interroger sur leur signification et à développer leur pensée critique. Ils incitent les auditeurs à remettre en question leurs croyances et à approfondir leur compréhension des concepts philosophiques.
1.5. Expression de l'ineffable :
Certains aspects de la réalité, selon Platon, sont difficiles, voire impossibles, à exprimer de manière directe par les mots ou la raison. Les mythes permettent d'aborder ces sujets difficiles de manière imagée et symbolique, fournissant ainsi une représentation suggestive et évocatrice de la vérité.
En conclusion, le mythe joue un rôle central dans la pensée platonicienne, en particulier dans "La République". Il sert à transmettre des vérités métaphysiques, à expliquer les principes moraux et éthiques, à communiquer des idées philosophiques complexes et à éveiller la pensée critique chez les lecteurs. Les mythes offrent une voie alternative et puissante pour accéder à des vérités profondes qui dépassent souvent les limites de la raison et du langage.
2. La récompense des âmes justes et le cycle des réincarnations
Dans "La République", Platon évoque la question de la récompense des âmes justes après la mort et introduit la notion du cycle des réincarnations, également connu sous le nom de "transmigration des âmes" ou "métensomatose". Cette conception est développée dans le mythe d'Er, qui apparaît dans le Livre X de l'ouvrage.
1. Le mythe d'Er :
Le mythe d'Er est raconté par Socrate, et il présente le récit d'un soldat, Er, qui est revenu à la vie après avoir été déclaré mort pendant douze jours. Pendant ce temps, l'âme d'Er a quitté son corps et a voyagé vers l'au-delà, où elle a été témoin du jugement et de la récompense des âmes après leur mort.
Selon le mythe, les âmes des morts se rassemblent dans une plaine et sont jugées par des juges célestes. Les âmes sont ensuite dirigées vers deux chemins différents : l'un menant à la vie éternelle et à la félicité, et l'autre menant à une nouvelle incarnation terrestre. Le choix du chemin dépend de la vie que chaque âme a menée et de son degré de justice.
2. La récompense des âmes justes :
Platon affirme que les âmes qui ont mené une vie juste et vertueuse seront récompensées par une existence bénie après la mort. Elles peuvent être réincarnées dans un corps plus noble et plus divin, ou elles peuvent rejoindre les îles des Bienheureux, où elles vivront éternellement dans la félicité, en contemplant les idées et les Formes éternelles.
Ces âmes justes ont acquis la sagesse et la vertu tout au long de leurs vies et se sont libérées de l'emprise des désirs matériels et des passions. Elles sont donc capables de transcender le cycle des réincarnations et de se connecter à la réalité supérieure des idées.
3. Le cycle des réincarnations :
Pour les âmes qui n'ont pas mené une vie juste, le mythe d'Er présente l'idée d'un cycle de réincarnations. Ces âmes sont condamnées à retourner sur Terre dans un nouveau corps, où elles auront l'opportunité de s'améliorer et de progresser vers une existence plus vertueuse.
Le cycle des réincarnations est une forme de punition et de purification, où les âmes doivent réapprendre les leçons qu'elles n'ont pas assimilées dans leurs vies précédentes. Ce processus continue jusqu'à ce que l'âme parvienne à la sagesse et à la vertu nécessaires pour échapper au cycle des réincarnations.
4. L'importance de la justice et de la sagesse :
Le mythe d'Er souligne l'importance fondamentale de la justice et de la sagesse dans la vie humaine. Platon présente la vie comme une opportunité pour les âmes d'acquérir la sagesse, de cultiver la vertu et de progresser vers une existence plus élevée et plus significative. La recherche de la justice et de la sagesse est donc cruciale pour éviter un cycle interminable de réincarnations et pour aspirer à la récompense d'une vie bienheureuse et éternelle.
Dans "La République", Platon présente la récompense des âmes justes après la mort et propose la notion du cycle des réincarnations pour les âmes qui n'ont pas mené une vie vertueuse. Le mythe d'Er met en évidence l'importance de la justice et de la sagesse dans la vie humaine, soulignant que les âmes justes seront récompensées par une existence bénie, tandis que les âmes injustes seront soumises à un cycle de réincarnations jusqu'à ce qu'elles atteignent la sagesse et la vertu nécessaires pour se libérer du cycle.
III. Héritage de "La République" dans la pensée philosophique
A. Influence et réception de l'œuvre de Platon à travers l'histoire
L'œuvre de Platon, et en particulier "La République", a eu une influence profonde et durable sur la pensée philosophique et politique à travers l'histoire. Son impact s'étend sur plusieurs domaines, de la philosophie à la politique en passant par la religion, l'éducation et la littérature. Voici un aperçu de l'influence et de la réception de l'œuvre de Platon à travers les siècles :
1. L'Antiquité :
Déjà de son vivant, Platon a fondé l'Académie, une école de philosophie qui est devenue l'une des institutions les plus importantes de l'Antiquité. Son enseignement a attiré de nombreux disciples et a inspiré des générations de penseurs. Les dialogues de Platon ont été largement diffusés et étudiés, et ses idées ont été discutées et critiquées par des philosophes contemporains tels qu'Aristote.
2. Le Moyen Âge :
Au Moyen Âge, l'influence de Platon a été transmise principalement par l'intermédiaire de commentateurs tels que Plotin et Proclus, qui ont joué un rôle crucial dans la préservation et la diffusion de ses textes. Les idées platoniciennes ont été intégrées dans la pensée des philosophes médiévaux et des théologiens chrétiens, notamment dans le développement de la théologie néoplatonicienne.
3. La Renaissance :
La redécouverte des textes anciens pendant la Renaissance a conduit à un regain d'intérêt pour la philosophie de Platon. Les penseurs de la Renaissance, tels que Marsile Ficin et Giovanni Pico della Mirandola, ont étudié et interprété les œuvres de Platon, en particulier son idéalisme et son éthique.
4. L'Âge des Lumières :
Au XVIIIe siècle, l'influence de Platon a été réexaminée et critiquée par les philosophes des Lumières. Certains, comme Voltaire, ont critiqué son concept de la République idéale comme étant utopique et irréalisable. Cependant, d'autres, comme Rousseau, ont été influencés par les idées de Platon sur la justice et la vertu dans la société.
5. Le XIXe et le début du XXe siècle :
L'œuvre de Platon a continué d'exercer une influence significative sur la philosophie occidentale au XIXe siècle. Les philosophes idéalistes allemands, tels que Friedrich Schelling et Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ont été influencés par ses conceptions métaphysiques et ses idées sur la réalité des idées. Les philosophes existentialistes, comme Kierkegaard et Heidegger, ont également été inspirés par les idées de Platon sur la vérité et l'authenticité.
6. L'influence contemporaine :
De nos jours, l'œuvre de Platon continue d'être étudiée et discutée par les philosophes du monde entier. Ses idées sur la justice, la vertu, la connaissance, la politique et la métaphysique restent pertinentes et stimulantes pour les débats philosophiques actuels. "La République" est considérée comme l'une des œuvres majeures de la philosophie occidentale et continue de susciter des réflexions sur la nature de la justice, la structure idéale de la cité et la quête de la vérité.
L'œuvre de Platon, et en particulier "La République", a eu une influence considérable sur la pensée philosophique, politique et culturelle à travers l'histoire. Ses idées ont été transmises et interprétées par des générations de penseurs et ont inspiré des courants philosophiques divers. La pertinence continue de ses idées témoigne de l'importance durable de la pensée platonicienne dans le développement de la philosophie occidentale.
B. La notion de justice et son évolution dans la philosophie occidentale
La notion de justice a été un sujet central de réflexion dans la philosophie occidentale depuis l'Antiquité. L'influence de Platon et d'autres philosophes anciens a jeté les bases de la compréhension de la justice, tandis que les penseurs ultérieurs ont enrichi et développé cette conception. Voici un aperçu de l'évolution de la notion de justice dans la philosophie occidentale :
1. La justice chez les philosophes grecs :
Platon a joué un rôle crucial dans la définition de la justice comme une vertu fondamentale de l'âme et de la cité idéale. Pour Platon, la justice implique l'harmonie et l'équilibre entre les différentes parties de l'âme (la raison, l'esprit et l'appétit) ainsi qu'entre les différentes classes sociales de la cité. La justice est étroitement liée à la vertu, à la sagesse et à l'idée d'un ordre naturel et harmonieux dans la société.
Aristote, élève de Platon, a également abordé la justice dans son œuvre. Il distingue deux formes de justice : la justice distributive, qui concerne la répartition équitable des biens et des honneurs dans la société, et la justice corrective, qui consiste à rendre ce qui est dû en cas d'injustice. Aristote souligne l'importance de l'équité et de la prudence dans l'application de la justice.
2. La justice dans la pensée chrétienne :
L'influence du christianisme a apporté une nouvelle dimension à la notion de justice. Les penseurs chrétiens ont développé l'idée d'une justice divine qui transcende la justice humaine. Pour les théologiens chrétiens, la justice est associée à l'amour, à la miséricorde et au pardon de Dieu envers les humains pécheurs. Le concept de la justice comme rétribution pour le bien et le mal a été étendu à l'au-delà, avec la notion de récompense éternelle ou de châtiment pour les actions commises dans cette vie.
3. La justice dans la philosophie moderne :
Au cours de la période moderne, des penseurs tels que Thomas Hobbes, John Locke, et Jean-Jacques Rousseau ont abordé la question de la justice dans le contexte de la théorie politique et du contrat social. Hobbes a considéré la justice comme une convention sociale nécessaire pour éviter l'état de guerre permanent entre les individus. Locke a mis l'accent sur la propriété privée comme fondement de la justice, tandis que Rousseau a souligné l'importance de la justice sociale et de l'égalité dans la société.
Immanuel Kant a également apporté une contribution importante à la compréhension de la justice en établissant le concept de justice comme éthique, basée sur le respect des devoirs moraux et du principe d'universalité.
4. La justice contemporaine :
Dans la philosophie contemporaine, la notion de justice continue d'être explorée et débattue dans divers contextes. Des théories de la justice comme celle de John Rawls ont mis l'accent sur l'idée de justice distributive, qui vise à assurer l'équité et l'égalité des chances dans la société.
La justice sociale, la justice environnementale, la justice économique et d'autres formes de justice spécifique ont émergé en tant que domaines de recherche importants, chacun visant à résoudre des problèmes sociaux spécifiques liés à la justice.
En conclusion, la notion de justice a évolué de manière significative dans la philosophie occidentale depuis l'Antiquité. Des idées platoniciennes sur la justice comme vertu et harmonie ont été enrichies et développées par d'autres philosophes tout au long de l'histoire. La justice continue d'être un sujet de réflexion et de débat dans la philosophie contemporaine, avec des approches variées qui cherchent à aborder les enjeux de justice dans la société.
C. La vision politique et éthique de Platon et son impact sur la pensée politique moderne
La vision politique et éthique de Platon, telle qu'exprimée dans "La République", a eu une influence profonde sur la pensée politique moderne. Ses idées sur la justice, la vertu, le rôle du gouvernement et la structure idéale de la cité ont suscité des débats et des interprétations à travers les siècles, et continuent d'inspirer les réflexions sur la politique contemporaine. Voici comment la vision politique et éthique de Platon a influencé la pensée politique moderne :
1. Justice et bien commun :
La notion de justice chez Platon est étroitement liée au bien commun et à l'harmonie sociale. Il considère que la justice réside dans l'équilibre et la coopération entre les différentes classes sociales, chacune remplissant sa fonction spécifique dans la cité idéale. Cette idée de la justice comme bien commun a influencé les théories politiques ultérieures, notamment la théorie du contrat social de John Locke et les idées de John Rawls sur la justice comme équité.
2. Gouvernement des gardiens-philosophes :
Platon propose que la cité idéale soit gouvernée par des gardiens-philosophes, des individus sages et vertueux qui sont capables de diriger avec sagesse et bienveillance. Cette vision d'un gouvernement dirigé par des penseurs éclairés a inspiré les théories du philosophe-roi et du despotisme éclairé de plusieurs penseurs, dont Thomas More, Thomas Hobbes et Voltaire.
3. L'éducation des gardiens :
Platon insiste sur l'importance de l'éducation dans la formation de dirigeants justes et sages. Les gardiens-philosophes sont soumis à une éducation rigoureuse et complète, comprenant l'étude des mathématiques, de la musique, de la géométrie et de la philosophie. Cette vision de l'éducation comme moyen de cultiver la vertu et la sagesse chez les dirigeants a influencé la pensée éducative à travers les âges, notamment dans les idées de l'éducation libérale.
4. Méritocratie et justice sociale :
La structure de la cité idéale de Platon repose sur le principe de la méritocratie, où les individus sont attribués à leur rôle dans la société en fonction de leurs capacités et de leur mérite plutôt que de leur naissance ou de leur richesse. Ce concept de justice sociale basée sur le mérite a été repris par plusieurs penseurs politiques, notamment par John Rawls, qui a développé la théorie de la justice comme équité, mettant l'accent sur l'importance de l'égalité des chances et des mérites individuels.
5. La critique des régimes politiques dégradés :
Platon critique les régimes politiques dégradés, tels que l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie, en soulignant leurs faiblesses et leurs dangers. Cette critique des formes dégénérées de gouvernement a influencé la pensée politique en mettant en garde contre les excès du pouvoir et en soulignant l'importance d'une gouvernance équilibrée et juste.
En conclusion, la vision politique et éthique de Platon dans "La République" a eu un impact durable sur la pensée politique moderne. Ses idées sur la justice, le bien commun, le rôle du gouvernement, l'éducation des dirigeants et la critique des régimes politiques dégradés ont influencé de nombreux penseurs politiques ultérieurs. La quête de la justice, de la vertu et de la sagesse demeure un idéal central dans la philosophie politique inspirée par les réflexions de Platon sur la cité idéale.
IV. Conclusion
A. Récapitulation des points clés de "La République" de Platon
"La République" de Platon est l'une des œuvres les plus influentes de la philosophie occidentale. Voici une récapitulation des points clés de cet ouvrage majeur :
1. La quête de la justice :
"La République" commence par un dialogue entre Socrate et ses interlocuteurs, cherchant à définir la justice. Socrate réfute plusieurs définitions proposées par ses interlocuteurs et finit par établir que la justice est l'harmonie de l'âme et de la cité, où chaque partie remplit sa fonction propre.
2. La construction de la cité idéale (Kallipolis) :
Platon imagine une cité idéale, Kallipolis, composée de trois classes sociales : les producteurs, les gardiens et les philosophes-rois. Chaque classe a une fonction spécifique et contribue à l'harmonie de la cité.
3. Les gardiens-philosophes :
Les gardiens-philosophes sont les dirigeants de la cité idéale. Ils sont sélectionnés et formés dès leur enfance pour être justes, sages et vertueux. Ils détiennent le pouvoir politique en vertu de leur sagesse et non de leur naissance.
4. L'éducation des gardiens-philosophes :
L'éducation des gardiens est essentielle pour assurer la stabilité de la cité. Ils sont soumis à une éducation rigoureuse qui comprend l'étude des mathématiques, de la musique et de la philosophie.
5. L'allégorie de la caverne :
Dans le Livre VII, Platon présente l'allégorie de la caverne, qui symbolise le cheminement de l'ignorance vers la connaissance. L'homme emprisonné dans la caverne est libéré de ses chaînes et émerge dans le monde des idées, représentant ainsi l'ascension de l'âme vers la vérité.
6. La dégénérescence des régimes politiques :
Platon décrit la dégénérescence de la cité idéale en trois régimes politiques dégradés : l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Chaque régime est caractérisé par une corruption croissante et un déséquilibre de la justice.
7. La récompense des âmes justes :
Platon aborde la récompense des âmes justes après la mort dans le mythe d'Er. Les âmes justes seront récompensées par une existence bénie dans l'au-delà, tandis que les âmes injustes subiront le cycle des réincarnations jusqu'à ce qu'elles acquièrent la sagesse nécessaire pour être libérées.
8. La dialectique socratique :
La dialectique, un outil philosophique utilisé par Socrate, est employée tout au long de l'œuvre pour examiner les idées et les concepts. Elle encourage le raisonnement critique et la recherche de la vérité.
9. Le parallèle entre l'âme individuelle et la cité :
Platon établit un parallèle entre l'âme individuelle et la cité, montrant comment leur déclin moral peut mener à des régimes politiques dégradés et à la corruption sociale.
"La République" de Platon est une œuvre majeure de la philosophie qui aborde des thèmes fondamentaux tels que la justice, la vertu, le gouvernement et la quête de la vérité. La vision politique et éthique de Platon a eu un impact durable sur la pensée politique et philosophique à travers l'histoire, et ses idées continuent de susciter des débats et des réflexions dans le monde contemporain.
B. Importance durable de l'œuvre dans la philosophie et la politique
"La République" de Platon a une importance durable dans la philosophie et la politique en raison de la profondeur de ses idées et de son influence continue sur la pensée occidentale. Voici quelques raisons qui expliquent cette importance :
1. Exploration de la justice et de la vertu :
"La République" constitue l'une des premières tentatives systématiques pour définir et explorer la notion de justice. La réflexion sur la justice et la vertu a perduré tout au long de l'histoire de la philosophie, influençant la pensée éthique et politique ultérieure.
2. Vision politique idéaliste :
La cité idéale (Kallipolis) proposée par Platon dans "La République" a marqué l'histoire de la philosophie politique en tant que modèle d'une société idéale et juste. Sa vision d'un gouvernement dirigé par des gardiens-philosophes, sélectionnés et formés pour être justes et sages, a inspiré de nombreuses théories politiques et utopies à travers les siècles.
3. L'allégorie de la caverne et la quête de la vérité :
L'allégorie de la caverne, l'un des passages les plus célèbres de l'œuvre, explore la nature de la connaissance et la quête de la vérité. Cette allégorie a suscité des débats sur la nature de la réalité, de la perception et de la vérité, et continue d'être une métaphore puissante pour la compréhension de la connaissance et de la conscience humaine.
4. Le concept d'éducation :
Platon insiste sur l'importance de l'éducation dans la formation de dirigeants justes et sages. Son idée d'une éducation rigoureuse et complète pour les gardiens-philosophes a influencé la réflexion sur l'éducation dans le cadre politique et éthique.
5. La dialectique socratique :
La méthode dialectique utilisée par Socrate dans "La République" est devenue un modèle de raisonnement philosophique, encourageant le questionnement critique et l'examen des idées et des concepts.
6. Influence sur les penseurs ultérieurs :
"La République" a influencé de nombreux philosophes et penseurs politiques tout au long de l'histoire, tels que Saint Augustin, Thomas More, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Karl Popper et John Rawls, pour n'en citer que quelques-uns. Ces penseurs ont été influencés par les idées de Platon sur la justice, la politique, la connaissance et la vertu, et ont souvent développé leurs propres théories en dialogue avec ses idées.
"La République" de Platon est un ouvrage qui a eu une influence considérable et durable dans la philosophie et la politique. Ses idées sur la justice, la vertu, la politique idéale et la quête de la vérité ont façonné la pensée occidentale et continuent de susciter des débats et des réflexions dans le contexte contemporain. L'œuvre demeure une source d'inspiration pour les penseurs et les chercheurs, et son héritage philosophique continue de nourrir la réflexion sur des questions fondamentales de la vie humaine en société.
C. Invitation à poursuivre la réflexion sur la justice et l'idéal de la cité juste
"La République" de Platon nous invite à poursuivre la réflexion sur des questions fondamentales concernant la justice et l'idéal de la cité juste. Les idées présentées par Platon dans cette œuvre classique continuent de susciter l'intérêt et la pertinence dans le monde contemporain, où les défis politiques, sociaux et éthiques demeurent nombreux. Voici quelques pistes de réflexion pour approfondir ces thèmes :
1. Le concept de justice :
"La République" nous incite à continuer d'explorer la notion de justice et ses différentes facettes. Comment pouvons-nous définir la justice dans nos sociétés contemporaines ? Comment concilier les différentes conceptions de la justice qui peuvent exister au sein d'une société plurielle et diversifiée ? Quels sont les principes éthiques fondamentaux qui devraient guider notre compréhension de la justice ?
2. La quête de la vérité :
L'allégorie de la caverne de Platon met en évidence la quête de la vérité et la nécessité de sortir des idées préconçues et des illusions pour accéder à la connaissance véritable. Comment pouvons-nous appliquer cette idée à notre propre vie intellectuelle et sociale ? Comment pouvons-nous encourager la recherche de la vérité et du savoir dans nos sociétés ?
3. Le rôle de l'éducation :
Platon met en avant l'importance de l'éducation dans la formation de dirigeants justes et sages. Comment pouvons-nous repenser nos systèmes éducatifs pour favoriser la formation de citoyens responsables, critiques et vertueux ? Comment pouvons-nous promouvoir une éducation qui vise à développer à la fois l'intelligence et le caractère moral ?
4. Les idéaux politiques :
L'idéal de la cité juste présenté par Platon soulève des questions sur la nature du gouvernement et des institutions politiques. Comment pouvons-nous créer des systèmes politiques qui favorisent la justice et l'épanouissement de tous les membres de la société ? Quels sont les principes et les valeurs qui devraient guider notre action politique pour atteindre un idéal de cité plus juste et équitable ?
5. La récompense des âmes justes :
Le mythe d'Er soulève des interrogations sur la question de la récompense des actions justes et vertueuses. Comment pouvons-nous encourager et récompenser la vertu et la justice dans nos sociétés ? Comment pouvons-nous concevoir la récompense des bonnes actions au-delà de la notion traditionnelle de récompense dans l'au-delà ?
"La République" de Platon nous offre une base solide pour approfondir notre compréhension de la justice et de l'idéal de la cité juste. En poursuivant la réflexion sur ces thèmes, nous pouvons contribuer à façonner des sociétés plus justes, équitables et vertueuses, tout en continuant d'honorer l'héritage intellectuel et philosophique laissé par ce grand penseur de l'Antiquité.
